possibl*
↑ objectName, objectTitle:
objectTitle :
collectionName : collectionNameinventoryNb : inventoryNb
objectName : objectName
objectTitle : objectTitle
objectCulture : objectCulture
geography : geography
dating : dating
material : material
technique : technique
dimensions : dimensions
legalRightOwner : legalRightOwner
objectDescription : objectDescription

↑ , Guitare à cinq choeurs:
Guitare à cinq choeurs :
collectionName : Instruments à cordesinventoryNb : 0550
objectName :
objectTitle : Guitare à cinq choeurs
objectCulture :
geography :
dating : ca. AD 1640
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 87,5 cm, Largeur: 26 cm, Profondeur: 13 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : La guitare inv. n° 0550 a été acquise en 1879 par le premier conservateur de l’ancien Musée instrumental du Conservatoire de Bruxelles, Victor-Charles Mahillon. Elle appartenait auparavant au célèbre luthier Auguste Tolbecque. Sur le chevillier figure l’inscription « Matheo Sellas / alla Corona in / Venetia ». Sellas était un luthier d’origine allemande, actif à Venise durant la première moitié du XVIIe siècle. La guitare est montée de cinq chœurs de deux cordes fixées à l’aide de dix chevilles dorsales. Le dos se compose de 23 côtes de palissandre séparées par des filets d’ivoire. La rose qui orne la table d’harmonie est en plomb et n’est sans doute pas d’origine. Elle représente un personnage jouant du clavecin et est signée « H H ». Sans doute provient-elle d’un instrument à clavier de Jean-Henri Hemsch. Autour de la rose est disposée une large marqueterie d’ivoire, de pâte noire et de palissandre. La touche présente des plaques d’ivoire qui illustrent des fables de Phèdre ou d’Esope : « Le loup et la grue », ainsi que « Le renard et la cigogne ». L’arrière du manche est décoré d’une marqueterie d’ivoire et de pâte noire. À un moment de son histoire, cette guitare a été changée en chitarra battente, dont les cordes étaient fixées au bas de la caisse de résonance. À cette époque, le manche a été raccourci et est resté tel quel depuis lors. La guitare elle-même en revanche a été retransformée en guitare classique, avec un chevalet collé à la table. Il est possible que ce travail soit dû à Tolbecque. Des radiographies de l’instrument montrent d’importantes transformations internes, mais son aspect extérieur reste représentatif des qualités remarquables des guitares baroques. Bibliographie Victor-Charles Mahillon, Catalogue descriptif et analytique du Musée Instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, i, Gent, 1893, p. 481. Exposiçao Internacional de Instrumentos Antigos, V Festival Gulbenkian de Musica, Lisbonne, 1961, n° 39. Instruments de musique des XVIe et XVIIe siècles, catalogue de l’exposition du Musée Instrumental de Bruxelles en l’Hôtel de Sully, Paris, juin 1969, s.l., 1969, n° 31. Mia Awouters, "Befaamde barokgitaren uit de verzameling van het Brussels Instrumentenmuseum", Musica Antiqua, 3/3, 1986, p. 74-75. http://www.mim.be/fr/guitare-baroque?from_i_m=1
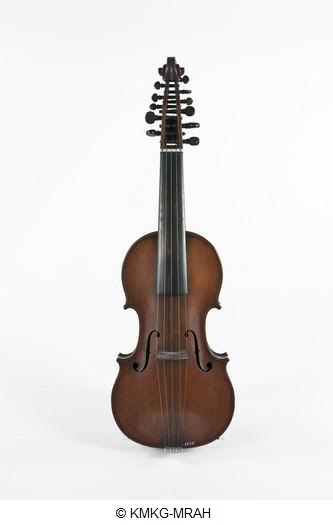
↑ , Quinton d'amour:
Quinton d'amour :
collectionName : Instruments à cordesinventoryNb : 1358
objectName :
objectTitle : Quinton d'amour
objectCulture :
geography :
dating : AD 1730 - AD 1772
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 64,6 cm, Largeur: 20,3 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Quinton d’amour pourvu de cinq cordes mélodiques et de six cordes sympathiques, couvert d’un vernis brun-rouge. Toutes les cordes sont attachées à une plaque blanchâtre équipée de pointes et fixée à l’éclisse du bas, comme sur le quinton d’amour et la viole d’amour de Salomon inv. n° 0480 et 1389. Les cordes sympathiques passent par-dessus la plaque blanche dans laquelle sont percés des trous pour les cordes mélodiques. L’instrument n’a dès lors pas de cordier. Le dos voûté est construit en deux parties et orné d’un filet à triple brin. Il est fait d’érable ondé, de même que les éclisses. La caisse de résonance a la forme d’un violon ; l’intérieur est équipé de tasseaux et de contre-éclisses. La table d’harmonie, composée de deux pièces d’épicéa, est percée d’ouïes en forme de f et également ornée d’un filet à trois brins. Elle présente des fractures qui ont été réparées. Dans le tasseau supérieur, on distingue trois trous de clous qui ont anciennement dû servir à fixer le manche. Une volute de violon classique surmonte le chevillier. Celui-ci est orné de motif floraux à l’arrière et sur les côtés. A l’avant, il est entièrement ouvert, tandis qu’à l’arrière, il est fermé à hauteur de quatre des cinq cordes mélodiques. La touche, qui est creusée à l’arrière afin de laisser passer les cordes sympathiques, est plaquée d’ébène et porte les traces de frettes nouées. Cet instrument présente des similitudes avec le quinton d’amour de Salomon inv. n° 0481, mais le bord et les coins de la table et du dos sont plus épais. La couleur et la texture du vernis diffèrent par ailleurs des deux autres instruments de Salomon conservés au MIM (inv. n° 0481 et 1389). Il est possible que cet instrument-ci ait été assemblé, modifié voire entièrement construit par un certain Jean Nicolas Leclerc, qui a laissé une signature au crayon à l’intérieur de la caisse. Peut-être s’agit-il de Joseph-Nicolas Leclerc de Mirecourt, actif à Paris à partir de 1760. Ce quinton d’amour faisait partie de la collection d’Auguste Tolbecque. En 1879, celle-ci fut acquise par le Musée des instruments de musique. En 1885, une viole d’amour de Salomon appartenant au musée fut exposée à Londres. Peut-être était-ce cet instrument-ci, le quinton d’amour inv. n° 0481 ou la viole d’amour inv. n° 1389, également de sa main. Inscriptions 1) “SALOMON / A PARIS” (marque au fer) 2) “Jean nicolas / leclerc” (signature manuscrite dans la caisse, sur le dos) Longueur ca. 65,2 cm Largeur ca. 25 cm Hauteur des éclisses ca. 31 cm Longueur vibrante ca. 32,8 cm Bibliographie Victor-Charles Mahillon, Catalogue descriptif et analytique du Musée Instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, vol. 3, Gand, 1880, 2/1893, p. 26.

↑ , orgue éléctrostatique Dereux:
orgue éléctrostatique Dereux :
collectionName : Instruments électriques et électroniquesinventoryNb : 2016.0098.001
objectName :
objectTitle : orgue éléctrostatique Dereux
objectCulture :
geography :
dating : AD 1973
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 111,5 cm, Largeur: 126,5 cm, Profondeur: 106 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : http://www.mim.be/fr/les-orgues-electrostatiques-de-dereux-0 Le mim possède trois orgues électrostatiques de l'ingénieur français Jean-Adolphe Dereux (1896-1968). Les deux plus grands possèdent deux claviers et une pédale (n° 2016.0098.001 et 2018.0079.001), tandis que le plus petit instrument (n° 2016.0098.002) dispose d'un seul clavier. Le musicien y contrôle le volume à l'aide des pédales (figures 1a et 1b). Les trois orgues sont un don de Pieter de Jong, qui les a restaurés pour les rendre jouables. Dereux considérait les orgues électroniques de son temps comme pas suffisamment capable d'imiter les sons de l'orgue à tuyaux. Il développa donc un système permettant de visualiser les timbres des tuyaux d'orgue et de les restituer électroniquement de la manière la plus authentique possible. Ainsi naquit au début des années 1950 l'orgue électrostatique Dereux. Le son y est créé par le courant traité par un générateur dans lequel un disque en mouvement tourne entre deux disques durs (Fig. 2a). Ces disques durs contiennent des informations, notamment des diagrammes sonores. En utilisant un oscillographe, Dereux réalisa un graphique des vibrations des tuyaux d'orgue. Ces tuyaux furent sélectionnés avec soin afin de trouver ceux de la meilleure qualité. Le choix de l'ingénieur se porta sur ceux du facteur d'orgues français Cavaillé-Coll. Les oscillogrammes permirent des enregistrements photographiques des sons (diagrammes). Dereux réussit ainsi à enregistrer 24 jeux d'orgue différents pour chacune des douze notes, en sept octaves. Il disposa méticuleusement ces diagrammes sur un disque. Comme ce disque était trop grand pour être incorporé dans un instrument, il fut réduit photographiquement à un cliché négatif, reproduit à son tour par photogravure à une taille utilisable. Cette information sonore est alors appliquée à l'un des deux disques durs du générateur, à savoir le côté argent (plastique dur avec argent évaporé). L'autre disque dur, côté cuivre, sert à la connexion au boîtier de commande et aux registres. Entre ces deux disques tourne un disque mobile (le disque de balayage), composé d'un certain nombre de faisceaux de balayage en filigrane argent (Fig. 2a et 2b). Chaque fois qu'un de ces faisceaux se déplace le long d'un diagramme, il y a génération de courant (électrostatique). Ce courant n'est envoyé à l'amplificateur (et au haut-parleur) que lorsque l'organiste active un ou plusieurs jeux et appuie sur une touche. Comme notre système musical comporte douze tons, chaque ton d'un orgue Dereux possède son propre générateur (Fig. 3). Tous sont identiques et entraînés par la même courroie de transmission. Le fait qu'ils fonctionnent tous à des vitesses différentes est dû à l'épaisseur différente des arbres moteurs. Les orgues Dereux ne possèdent pas de haut-parleur intégré. Un haut-parleur (externe) est donc spécialement conçu afin d'imiter au maximum l'effet des tuyaux acoustiques. Il est équipé d'enceintes de résonance en forme de colonne à double ouverture montées sur le haut-parleur (Fig. 4a et 4b). Il n'est pas surprenant que ces orgues conviennent à merveille pour les églises, en particulier les grands orgues à deux claviers et une pédale (Fig. 5). Les catalogues de vente ne laissent aucun doute sur le fait que le clergé et les conseils de fabrique soient des clients appropriés. Les avantages sur l'orgue à tuyaux étaient nombreux selon les vendeurs : "... des pièces inusables... faciles à entretenir... aucun risque de dommages par les systèmes de chauffage dans les églises... les essences de bois[de la caisse] ont subi un traitement spécial... impossible que l'orgue Dereux devienne déplaisant, son harmonisation est absolument constante... facile à installer dans les salles les plus étroites[et] des appartements et maisons aux dimensions normales... le prix d'un orgue électrostatique est le cinquième environ d'un orgue à tuyaux ... » (vers 1960 le prix était encore de 150.000 francs belges, un montant non négligeable). Si ces arguments n'avaient pas encore convaincu l'acheteur potentiel, restait l'argument suprême, celui qui en appelle au divin : "Enfin, c'est une grande création de l'esprit humain qui est mise au service de Dieu puis de l'humanité, car elle aide celle-ci à élever sa pensée vers Dieu et vers les beautés de l'Art". Illustrations 1a Orgue électrostatique, Jean-Adolphe Dereux, Paris,1953, inv. 2016.0098.002 1b Le clavier possède 5 octaves mais peut être étendu à 5 ½ octaves s'il est repoussé par le bas et qu'une touche (un demi-ton) est décalée. De cette façon, il est possible de transposer 2a Deux images des catalogues de vente présentant les deux disques durs et le disque de balayage rotatif 2b Le disque de balayage (en haut) et un disque dur (en bas) 3 Générateurs de sons 4 a & b Hault-parleur 5 Orgue électrostatique, Jean-Adolphe Dereux, Paris, 1973, inv. 2016.0098.001

↑ , electrostatic organ Dereux:
electrostatic organ Dereux :
collectionName : Instruments électriques et électroniquesinventoryNb : 2016.0098.002
objectName :
objectTitle : electrostatic organ Dereux
objectCulture :
geography :
dating :
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 96 cm, Largeur: 117 cm, Profondeur: 45 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : http://www.mim.be/fr/les-orgues-electrostatiques-de-dereux-0 Le mim possède trois orgues électrostatiques de l'ingénieur français Jean-Adolphe Dereux (1896-1968). Les deux plus grands possèdent deux claviers et une pédale (n° 2016.0098.001 et 2018.0079.001), tandis que le plus petit instrument (n° 2016.0098.002) dispose d'un seul clavier. Le musicien y contrôle le volume à l'aide des pédales (figures 1a et 1b). Les trois orgues sont un don de Pieter de Jong, qui les a restaurés pour les rendre jouables. Dereux considérait les orgues électroniques de son temps comme pas suffisamment capable d'imiter les sons de l'orgue à tuyaux. Il développa donc un système permettant de visualiser les timbres des tuyaux d'orgue et de les restituer électroniquement de la manière la plus authentique possible. Ainsi naquit au début des années 1950 l'orgue électrostatique Dereux. Le son y est créé par le courant traité par un générateur dans lequel un disque en mouvement tourne entre deux disques durs (Fig. 2a). Ces disques durs contiennent des informations, notamment des diagrammes sonores. En utilisant un oscillographe, Dereux réalisa un graphique des vibrations des tuyaux d'orgue. Ces tuyaux furent sélectionnés avec soin afin de trouver ceux de la meilleure qualité. Le choix de l'ingénieur se porta sur ceux du facteur d'orgues français Cavaillé-Coll. Les oscillogrammes permirent des enregistrements photographiques des sons (diagrammes). Dereux réussit ainsi à enregistrer 24 jeux d'orgue différents pour chacune des douze notes, en sept octaves. Il disposa méticuleusement ces diagrammes sur un disque. Comme ce disque était trop grand pour être incorporé dans un instrument, il fut réduit photographiquement à un cliché négatif, reproduit à son tour par photogravure à une taille utilisable. Cette information sonore est alors appliquée à l'un des deux disques durs du générateur, à savoir le côté argent (plastique dur avec argent évaporé). L'autre disque dur, côté cuivre, sert à la connexion au boîtier de commande et aux registres. Entre ces deux disques tourne un disque mobile (le disque de balayage), composé d'un certain nombre de faisceaux de balayage en filigrane argent (Fig. 2a et 2b). Chaque fois qu'un de ces faisceaux se déplace le long d'un diagramme, il y a génération de courant (électrostatique). Ce courant n'est envoyé à l'amplificateur (et au haut-parleur) que lorsque l'organiste active un ou plusieurs jeux et appuie sur une touche. Comme notre système musical comporte douze tons, chaque ton d'un orgue Dereux possède son propre générateur (Fig. 3). Tous sont identiques et entraînés par la même courroie de transmission. Le fait qu'ils fonctionnent tous à des vitesses différentes est dû à l'épaisseur différente des arbres moteurs. Les orgues Dereux ne possèdent pas de haut-parleur intégré. Un haut-parleur (externe) est donc spécialement conçu afin d'imiter au maximum l'effet des tuyaux acoustiques. Il est équipé d'enceintes de résonance en forme de colonne à double ouverture montées sur le haut-parleur (Fig. 4a et 4b). Il n'est pas surprenant que ces orgues conviennent à merveille pour les églises, en particulier les grands orgues à deux claviers et une pédale (Fig. 5). Les catalogues de vente ne laissent aucun doute sur le fait que le clergé et les conseils de fabrique soient des clients appropriés. Les avantages sur l'orgue à tuyaux étaient nombreux selon les vendeurs : "... des pièces inusables... faciles à entretenir... aucun risque de dommages par les systèmes de chauffage dans les églises... les essences de bois[de la caisse] ont subi un traitement spécial... impossible que l'orgue Dereux devienne déplaisant, son harmonisation est absolument constante... facile à installer dans les salles les plus étroites[et] des appartements et maisons aux dimensions normales... le prix d'un orgue électrostatique est le cinquième environ d'un orgue à tuyaux ... » (vers 1960 le prix était encore de 150.000 francs belges, un montant non négligeable). Si ces arguments n'avaient pas encore convaincu l'acheteur potentiel, restait l'argument suprême, celui qui en appelle au divin : "Enfin, c'est une grande création de l'esprit humain qui est mise au service de Dieu puis de l'humanité, car elle aide celle-ci à élever sa pensée vers Dieu et vers les beautés de l'Art". Illustrations 1a Orgue électrostatique, Jean-Adolphe Dereux, Paris,1953, inv. 2016.0098.002 1b Le clavier possède 5 octaves mais peut être étendu à 5 ½ octaves s'il est repoussé par le bas et qu'une touche (un demi-ton) est décalée. De cette façon, il est possible de transposer 2a Deux images des catalogues de vente présentant les deux disques durs et le disque de balayage rotatif 2b Le disque de balayage (en haut) et un disque dur (en bas) 3 Générateurs de sons 4 a & b Hault-parleur 5 Orgue électrostatique, Jean-Adolphe Dereux, Paris, 1973, inv. 2016.0098.001

↑ , orgue éléctrostatique Dereux:
orgue éléctrostatique Dereux :
collectionName : Instruments électriques et électroniquesinventoryNb : 2018.0079.001
objectName :
objectTitle : orgue éléctrostatique Dereux
objectCulture :
geography :
dating :
material :
technique :
dimensions :
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : http://www.mim.be/fr/les-orgues-electrostatiques-de-dereux-0 Le mim possède trois orgues électrostatiques de l'ingénieur français Jean-Adolphe Dereux (1896-1968). Les deux plus grands possèdent deux claviers et une pédale (n° 2016.0098.001 et 2018.0079.001), tandis que le plus petit instrument (n° 2016.0098.002) dispose d'un seul clavier. Le musicien y contrôle le volume à l'aide des pédales (figures 1a et 1b). Les trois orgues sont un don de Pieter de Jong, qui les a restaurés pour les rendre jouables. Dereux considérait les orgues électroniques de son temps comme pas suffisamment capable d'imiter les sons de l'orgue à tuyaux. Il développa donc un système permettant de visualiser les timbres des tuyaux d'orgue et de les restituer électroniquement de la manière la plus authentique possible. Ainsi naquit au début des années 1950 l'orgue électrostatique Dereux. Le son y est créé par le courant traité par un générateur dans lequel un disque en mouvement tourne entre deux disques durs (Fig. 2a). Ces disques durs contiennent des informations, notamment des diagrammes sonores. En utilisant un oscillographe, Dereux réalisa un graphique des vibrations des tuyaux d'orgue. Ces tuyaux furent sélectionnés avec soin afin de trouver ceux de la meilleure qualité. Le choix de l'ingénieur se porta sur ceux du facteur d'orgues français Cavaillé-Coll. Les oscillogrammes permirent des enregistrements photographiques des sons (diagrammes). Dereux réussit ainsi à enregistrer 24 jeux d'orgue différents pour chacune des douze notes, en sept octaves. Il disposa méticuleusement ces diagrammes sur un disque. Comme ce disque était trop grand pour être incorporé dans un instrument, il fut réduit photographiquement à un cliché négatif, reproduit à son tour par photogravure à une taille utilisable. Cette information sonore est alors appliquée à l'un des deux disques durs du générateur, à savoir le côté argent (plastique dur avec argent évaporé). L'autre disque dur, côté cuivre, sert à la connexion au boîtier de commande et aux registres. Entre ces deux disques tourne un disque mobile (le disque de balayage), composé d'un certain nombre de faisceaux de balayage en filigrane argent (Fig. 2a et 2b). Chaque fois qu'un de ces faisceaux se déplace le long d'un diagramme, il y a génération de courant (électrostatique). Ce courant n'est envoyé à l'amplificateur (et au haut-parleur) que lorsque l'organiste active un ou plusieurs jeux et appuie sur une touche. Comme notre système musical comporte douze tons, chaque ton d'un orgue Dereux possède son propre générateur (Fig. 3). Tous sont identiques et entraînés par la même courroie de transmission. Le fait qu'ils fonctionnent tous à des vitesses différentes est dû à l'épaisseur différente des arbres moteurs. Les orgues Dereux ne possèdent pas de haut-parleur intégré. Un haut-parleur (externe) est donc spécialement conçu afin d'imiter au maximum l'effet des tuyaux acoustiques. Il est équipé d'enceintes de résonance en forme de colonne à double ouverture montées sur le haut-parleur (Fig. 4a et 4b). Il n'est pas surprenant que ces orgues conviennent à merveille pour les églises, en particulier les grands orgues à deux claviers et une pédale (Fig. 5). Les catalogues de vente ne laissent aucun doute sur le fait que le clergé et les conseils de fabrique soient des clients appropriés. Les avantages sur l'orgue à tuyaux étaient nombreux selon les vendeurs : "... des pièces inusables... faciles à entretenir... aucun risque de dommages par les systèmes de chauffage dans les églises... les essences de bois[de la caisse] ont subi un traitement spécial... impossible que l'orgue Dereux devienne déplaisant, son harmonisation est absolument constante... facile à installer dans les salles les plus étroites[et] des appartements et maisons aux dimensions normales... le prix d'un orgue électrostatique est le cinquième environ d'un orgue à tuyaux ... » (vers 1960 le prix était encore de 150.000 francs belges, un montant non négligeable). Si ces arguments n'avaient pas encore convaincu l'acheteur potentiel, restait l'argument suprême, celui qui en appelle au divin : "Enfin, c'est une grande création de l'esprit humain qui est mise au service de Dieu puis de l'humanité, car elle aide celle-ci à élever sa pensée vers Dieu et vers les beautés de l'Art". Illustrations 1a Orgue électrostatique, Jean-Adolphe Dereux, Paris,1953, inv. 2016.0098.002 1b Le clavier possède 5 octaves mais peut être étendu à 5 ½ octaves s'il est repoussé par le bas et qu'une touche (un demi-ton) est décalée. De cette façon, il est possible de transposer 2a Deux images des catalogues de vente présentant les deux disques durs et le disque de balayage rotatif 2b Le disque de balayage (en haut) et un disque dur (en bas) 3 Générateurs de sons 4 a & b Hault-parleur 5 Orgue électrostatique, Jean-Adolphe Dereux, Paris, 1973, inv. 2016.0098.001

↑ , Harpe à pédales:
Harpe à pédales :
collectionName : Instruments à cordesinventoryNb : 3174
objectName :
objectTitle : Harpe à pédales
objectCulture :
geography :
dating : AD 1780 - AD 1795
material :
technique :
dimensions :
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : 36 cordes. Mécanique à crochets, 7 pédales. Caisse composée de neuf côtes de bois. Table percée de trois paires d’ouïes, chacune de sept ouvertures. Etendue : La -1 à La 5 Aucune inscription Décors : la caisse, colonne et console sont peintes en noir rehaussé d’or. La console est peinte de motifs de bouquets de fleurs et de papillons. La table est peinte de plusieurs trophées des arts et guirlandes de fleurs, près de la cuvette est peinte une scène galante. La cuvette comporte une frise dorée sur le devant, et des feuilles d’acanthe sur le dessus. Les pédales sont dorées. La colonne est de base carrée, elle est ornée de fleurs en plusieurs endroits. La volute de la crosse est ornée de feuilles d’acanthe et de boutons de roses, et est entièrement dorée. Cette harpe avait été décrite comme possiblement de la main du facteur Naderman, mais rien sur l’instrument ne nous permet d’affirmer cette provenance.

↑ , Manche en métal (possiblement d'un couteau):
Manche en métal (possiblement d'un couteau) :
collectionName : MérovingiensinventoryNb : B005758-019
objectName :
objectTitle : Manche en métal (possiblement d'un couteau)
objectCulture : Mérovingienne
geography :
dating :
material :
technique :
dimensions :
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : item has no descption

↑ , Modèle d'un serpent:
Modèle d'un serpent :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.00737
objectName :
objectTitle : Modèle d'un serpent
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 1545 BC - 1291 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 7,3 cm, Largeur: 5,5 cm, Profondeur: 2,1 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Cet objet en calcaire est un modèle de sculpteur. Provenant des fouilles de É. Naville dans le temple de Mentouhotep à Deir el-Bahari, il représente un serpent dans la forme spécifique d'uraeus. Il est possible qu'il s'agit de la déesse Meretseger, patronne de la nécropole thébaine. Elle fut adorée en compagnie du dieu Ptah dans un sanctuaire creusé dans le rocher, non loin de la Vallée des Reines. Fouille : Naville 1903-1904

↑ , Petits fragments de tissu avec motifs végétaux et animaliers:
Petits fragments de tissu avec motifs végétaux et animaliers :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.01047
objectName :
objectTitle : Petits fragments de tissu avec motifs végétaux et animaliers
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : AD 395 - AD 640
material :
technique :
dimensions :
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Proviennent de la tombe de la "Brodeuse Euphemia", Antinoé, fouilles Albert Gayet, 1899-1900.Ces petits fragments de textile sont comparables aux motifs présents sur le tissu couvrant l'épaule et le bras droits d'Euphemia. Il est possible qu'ils proviennent de ce textile.

↑ , Petite maison à lampe:
Petite maison à lampe :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.01091a
objectName :
objectTitle : Petite maison à lampe
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 30 BC - AD 395
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 4,4 cm, Largeur: 2,8 cm, Profondeur: 1,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Cet objet en terre cuite, qui provient des fouilles de W. F. Petrie à Héracléopolis Magna, constitue vraisemblablement un modèle de maison à lampe. La pièce de forme cylindrique est pourvue d'une ouverture rectangulaire par laquelle on introduisait une petite lampe à huile et d'un trou de suspension dans le toit. Il est possible que ce type de lampe fût employé dans un contexte religieux. Fouille : Petrie 1903-1904

↑ , Cercueil d’enfant:
Cercueil d’enfant :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.01182
objectName :
objectTitle : Cercueil d’enfant
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 332 BC - 30 BC (Incertaine)
material :
technique :
dimensions : Longueur: 77 cm, Largeur: 26,2 cm, Hauteur: 25 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : E.1182 - E.1183 Deux cercueils d’enfants Bois stuqué et peint Probablement fin de l’époque ptolémaïque (332-30 av. J.-C.) Provenance inconnue Ces deux petits cercueils sont de factures analogues et ils ont probablement appartenu à la même sépulture. A l’origine, leur surface était certainement couverte d’une épaisse couche de stuc, qui avait aussi permis de modeler les oreilles, mais qui a aujourd’hui presque disparu. Quelques traces de couleurs indiquent que les corps étaient totalement peints en jaune pâle, et le visage en un jaune plus foncé. Les visages des deux cercueils sont sculptés de manière sommaire et anguleuse, leurs traits semblent brutaux et leur nez, ainsi que leurs paupières, sont très accentués. Les chevelures rappellent les traditionnelles perruques tripartites. Le pilier dorsal d’un des deux cercueils adopte la forme d’un pilier djed, évocation de la colonne vertébrale d’Osiris. Ainsi, le défunt pourra, comme le dieu, se redresser dans l’Au-delà. Les deux cercueils ont été offerts au Musée en 1905 par le comte et la comtesse van den Steen de Jehay. Ils les avaient achetés en 1891, à Louxor, et il est possible qu’ils proviennent des fouilles qui avaient alors lieu dans la Vallée des Rois. A l’origine, ils contenaient encore les momies de deux enfants, qui ont disparu aujourd’hui.

↑ , Cercueil d’enfant:
Cercueil d’enfant :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.01183
objectName :
objectTitle : Cercueil d’enfant
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 332 BC - 30 BC
material :
technique :
dimensions : Longueur: 59,5 cm, Largeur: 20,5 cm, Hauteur: 21 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : E.1182 - E.1183 Deux cercueils d’enfants Bois stuqué et peint Probablement fin de l’époque ptolémaïque (332-30 av. J.-C.) Provenance inconnue Ces deux petits cercueils sont de factures analogues et ils ont probablement appartenu à la même sépulture. A l’origine, leur surface était certainement couverte d’une épaisse couche de stuc, qui avait aussi permis de modeler les oreilles, mais qui a aujourd’hui presque disparu. Quelques traces de couleurs indiquent que les corps étaient totalement peints en jaune pâle, et le visage en un jaune plus foncé. Les visages des deux cercueils sont sculptés de manière sommaire et anguleuse, leurs traits semblent brutaux et leur nez, ainsi que leurs paupières, sont très accentués. Les chevelures rappellent les traditionnelles perruques tripartites. Le pilier dorsal d’un des deux cercueils adopte la forme d’un pilier djed, évocation de la colonne vertébrale d’Osiris. Ainsi, le défunt pourra, comme le dieu, se redresser dans l’Au-delà. Les deux cercueils ont été offerts au Musée en 1905 par le comte et la comtesse van den Steen de Jehay. Ils les avaient achetés en 1891, à Louxor, et il est possible qu’ils proviennent des fouilles qui avaient alors lieu dans la Vallée des Rois. A l’origine, ils contenaient encore les momies de deux enfants, qui ont disparu aujourd’hui.

↑ , Modèle de manche d'herminette:
Modèle de manche d'herminette :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.02300
objectName :
objectTitle : Modèle de manche d'herminette
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : ca. 2066 BC - 1650 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 10 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Ce petit objet en bois est un modèle de manche d'herminette. Il est possible qu'il provienne d'une statuette faisant partie d'un modèle d'atelier de charpentiers (voir également E. 2299).

↑ , Tête de jeune roi:
Tête de jeune roi :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.03226
objectName :
objectTitle : Tête de jeune roi
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 664 BC - 332 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 13,9 cm, Largeur: 12,7 cm, Profondeur: 2,1 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Ce modèle représente la tête d'un jeune roi sculpté de profil. Il est coiffé d'un bonnet qui épouse la forme du crâne et qui fait apparaître la mèche caractéristique des enfants. Un grand uraeus orne son front. La tête se distingue également par des pupilles peintes en noir et par un double menton. Il est fort possible que la pièce est un moulage parachevé.

↑ , Fragment de relief de Nectanébo Ier:
Fragment de relief de Nectanébo Ier :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.04877h
objectName :
objectTitle : Fragment de relief de Nectanébo Ier
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 380 BC - 343 BC
material :
technique :
dimensions :
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Ce petit morceau de relief porte trois hiéroglyphes fragmentaires faisant partie du nom de "Fils de Rê" du premier roi de la XXXème Dynastie, Nectanébo Ier. Les traits de visage réalistes du sphinx sont très remarquables. Il est possible que la pièce provienne d'un temple de Tell Atrib dans le Delta.

↑ , Scarabée:
Scarabée :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05354c
objectName :
objectTitle : Scarabée
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 747 BC - 525 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 1,5 cm, Largeur: 1 cm, Profondeur: 1 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Le plat de ce scarabée à profil haut est usé. Il porte quelques signes, dont le disque solaire de Rê et, possiblement, le hiéroglyphe "mn". L'inscription pourrait représenter le nom d'Amon-rê.

↑ , Scarabée avec monture de bague en or:
Scarabée avec monture de bague en or :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05364
objectName :
objectTitle : Scarabée avec monture de bague en or
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 1850 BC - 1650 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 1,1 cm, Largeur: 0,9 cm, Profondeur: 0,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Le plat de ce petit scarabée porte trois hiéroglpyhes, possiblement la bouche "r" entre le bras "di" et un disque solaire "ra".
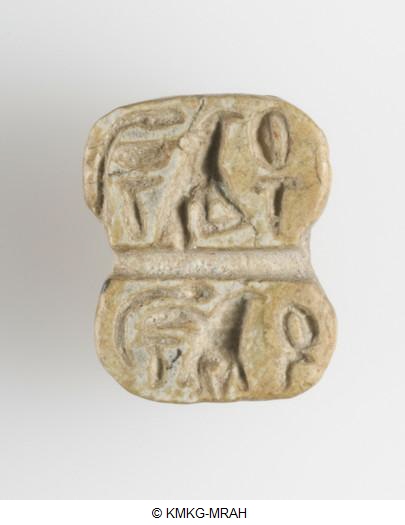
↑ , Scarabée double:
Scarabée double :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05590f
objectName :
objectTitle : Scarabée double
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 1295 BC - 656 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 0,9 cm, Largeur: 0,7 cm, Profondeur: 0,4 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Des scarabées doubles, constitués de deux petits scarabées et portant chacun sa propre décoration sur le revers, apparaissant à partir du Moyen Empire. Ce type connaît sont essor au Nouvel Empire. Les deux scarabées de cet exemplaire montrent la même composition : le faucon “Hr” derrière le signe de vie “ânkh”. Plusieurs hiéroglyphes se trouvent à gauche, possiblement le serpent “dj” et le signe “t”, formant ainsi le mot “dj.t” (‘éternité’). Cette composition peut donc être lue: “ankh Hr dj.t” (‘(que) Horus vive éternellement’). Des scarabées portant ce vœu sont connus pour la Période Ramesside et la Troisième Période Intermédiaire (XIXème-XXVème dyn.).

↑ , Fragment de scarabée 'de Bahariya':
Fragment de scarabée 'de Bahariya' :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05640
objectName :
objectTitle : Fragment de scarabée 'de Bahariya'
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 664 BC - 525 BC (Incertaine)
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 5,5 cm, Largeur: 5,5 cm, Profondeur: 2,8 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Les scarabées monolithes de lapis-lazuli qui atteignent les 8 cm de longueur sont particulièrement rares. Ceci représente un des plus grands scarabées de lapis-lazuli connus à présent. Sur le plat se trouvent des hiéroglyphes formant l’inscription “disdist” / “dsdst”, une version du nom ancien de l'oasis de Bahariya (“djsdjs”), dans le désert libyque, mention géographique inattendue sur un scarabée et qui autorise d'emblée à exclure l'objet du vaste corpus des scarabées de cœur, inscrits d’un chapitre du Livre des Morts. Le scarabée est perforé dans deux directions : d’une part transversalement, et d’autre part une petite perforation verticale a été creusée à partir du plat, au centre de l'objet. Les pattes ne sont pas sculptées, indiquant que l'objet était destiné à être serti dans un support ou une monture qui enserrait toute la base de l’objet, probablement en tant qu’élément de pectoral. Par ailleurs, il est probable que les perforations verticale et transversales ont servi à solidariser le scarabée avec son support : deux fils métalliques, partant de chaque côté ont pu se rejoindre au centre, la petite perforation verticale ayant permis d’en nouer les deux extrémités. Il est possible que le creusement des perforations ait entraîné la cassure du scarabée, peut-être même lors de sa fabrication.

↑ , Scarabée avec hiéroglyphes:
Scarabée avec hiéroglyphes :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05695
objectName :
objectTitle : Scarabée avec hiéroglyphes
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 1550 BC - 1295 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 1 cm, Largeur: 0,9 cm, Profondeur: 0,4 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Le plat de ce scarabée porte les hiéroglyphes suivants: le roseau "i", la plume d'autruche "maât" et le signe "nfr". Il s'agit possiblement d'un cryptogramme du nom d' Amon. Fouille : B.S.A.E. 1914

↑ , Scarabée:
Scarabée :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05709.1
objectName :
objectTitle : Scarabée
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 747 BC - 525 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 2,3 cm, Largeur: 1,5 cm, Profondeur: 0,9 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Le plat de ce scarabée porte plusieurs hiéroglyphes, de droite à gauche: le cobra, le canard, un disque solaire et trois traits horizontaux. Cette inscription réfère possiblement au nom d'Amon-Rê. Fouille : Griffith 1913-1914

↑ , Fragment de vase en verre:
Fragment de vase en verre :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05812.5
objectName :
objectTitle : Fragment de vase en verre
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 1545 BC - 1291 BC
material :
technique :
dimensions :
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Ce fragment de vase est un bel exemple de l'art de verrerie, qui a connu son apogée en Égypte pendant la XVIIIème Dynastie. Les verres étaient coulés en bandes de couleurs différentes autour d'un noyau extrait après refroidissement. Les motifs en forme de vagues étaient obtenus en étirant les bandeaux de couleurs au moyen d'un stylet. La surface du verre était ensuite polie. Il est possible que le fragment provienne d'un atelier thébain de l'époque d'Amenhotep III.

↑ , Fragment d'étude de sculpteur:
Fragment d'étude de sculpteur :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05830
objectName :
objectTitle : Fragment d'étude de sculpteur
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 1349 BC - 1333 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 12,5 cm, Largeur: 4,7 cm, Profondeur: 2,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Ce fragment de plaquette en calcaire est sculpté sur ses deux faces. Au recto, le centre de l'espace est occupé par un personnage assis de profil , représenté depuis la taille jusqu'en-dessous du genou. Dans le coin supérieur droit, on distingue les doigts de sa main tenant un bâton. Les doigts allongés et recourbés sont caractéristiques de l'art amarnien. Au recto, plusieurs lignes ont été gravées, sans qu'il soit possible d'identifier ce qu'elles devaient figurer à l'origine. Nous sommes ici en présence d'une étude de sculpteur. Elle faisait partie d'un lot de 18 pièces similaires (E.05820-E.05837) retrouvées sur le site d'Amarna lors des fouilles de W.M.F. Petrie et H. Carter en 1891-1892 et acquises par le musée en 1921. Un grand nombre de ce type d’artefacts a été retrouvé dans la ville d’ Amarna, essentiellement dans les ateliers, les maisons privées ou dans les tas de détritus où ils étaient parfois jetés après réalisation, n’ayant aucune valeur intrinsèque. Des plaquettes en pierre comme celle-ci servaient de support à l’apprentissage des artistes qui se devaient notamment d'apprendre le style propre au règne d'Akhenaton.

↑ , Scaraboïde en forme de visage humain:
Scaraboïde en forme de visage humain :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05860
objectName :
objectTitle : Scaraboïde en forme de visage humain
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 1295 BC - 945 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 2,1 cm, Largeur: 1,6 cm, Profondeur: 0,8 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : La production de scaraboïdes en forme de visage humain en faïence commence à l’Époque Ramesside en continue jusqu’à la Basse Époque. Le revers montre un personnage debout avec un cou long, possiblement le dieu Seth. À droite se trouvent une grande plume d’autruche de la déesse Maat et un disque solaire. Telles compositions apparaissent sur des scarabées datant des XIXème-XXIème dynasties.
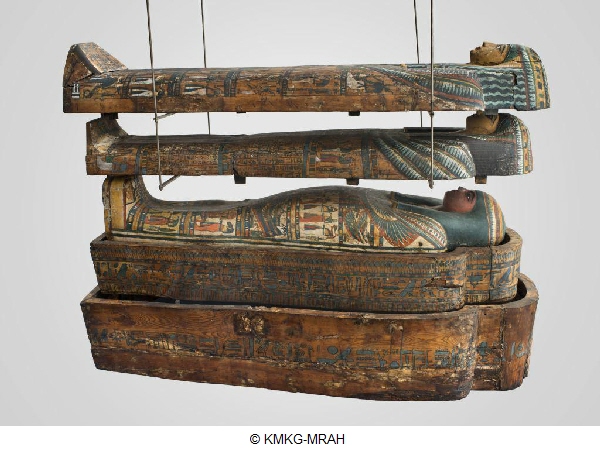
↑ , Cercueils de la dame Taânetenmes, et cartonnage de la dame Tamen:
Cercueils de la dame Taânetenmes, et cartonnage de la dame Tamen :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05890
objectName :
objectTitle : Cercueils de la dame Taânetenmes, et cartonnage de la dame Tamen
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 948 BC - 715 BC
material :
technique :
dimensions : Longueur: 192 cm, Largeur: 63 cm, Hauteur: 61 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Cercueils de la dame Taânetenmes, et cartonnage de la dame Tamen Bois stuqué et peint, cartonnage peint et momie Troisième Période Intermédiaire, probablement 22e dynastie (vers 945-715 av. J.-C.) Thèbes ouest Les formules d’offrande qui décorent ces cercueils momiformes mentionnent une propriétaire répondant au nom de Taânetenmes, la descendante d’une lignée de prêtres d’Amon à Karnak. Sur le couvercle de son cercueil intérieur, la défunte, vêtue d’une longue robe plissée, se dirige vers le lieu où l’on va statuer sur sa possible accession à l’Au-delà. Anubis (avec sa tête de chacal) contrôle, à l’aide d’une balance, si son cœur est en équilibre avec la plume de Maât, symbole de la Vérité. Tout semble en ordre, le monstre Ammit, laissera passer la défunte. Sous la « pesée du cœur », des colonnes de textes font état d’une seconde épreuve pour Taânetenmes : un interrogatoire sévère face au tribunal des dieux. Sans hésiter, elle récite la « confession négative » . Elle n’a commis aucune mauvaise action durant sa vie ! Entre les cercueils, se trouve un cartonnage coloré. Il contient le corps d’une autre défunte. Son nom, Tamen, se lit dans une formule d’offrande, sous le grand reliquaire à tête d’Osiris qui traverse toutes les scènes au centre. Avant d’arriver au Musée, les cercueils et le cartonnage ont été la propriété de plusieurs collections privées. Ce parcours compliqué a abouti à les considérer à tort comme un ensemble homogène. Le Musée Curtius de Liège possède un des cercueils de Tamen.

↑ , Groupe de singes:
Groupe de singes :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.06352
objectName :
objectTitle : Groupe de singes
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 1550 BC - 1069 BC (Incertaine)
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 6,5 cm, Largeur: 4 cm, Profondeur: 3,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Ce groupe de singes appartient au même type iconographique que la figurine provenant des fouilles de Gourob (E. 5792/03). Exécutée en calcaire, elle représente, sur un socle, un singe accroupi tenant deux petits contre lui. Il semble vouloir protéger les petits contre tout danger possible: l'expression de leurs visages, visibles de chaque côté, est un détail particulier. La pièce date vraisemblablement du Nouvel Empire.

↑ , Petit pot de pommade avec inscription:
Petit pot de pommade avec inscription :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.06407
objectName :
objectTitle : Petit pot de pommade avec inscription
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 2345 BC - 2181 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 5,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Ce petit pot en albâtre, qui aurait été découvert dans une tombe à Gebelein (voir aussi Bruxelles E. 6406), servait à contenir des essences parfumées. Il porte une inscription mentionnant le cartouche du pharaon Pépi I suivi de l'épithète "aimé d'Hathor, maîtresse de Dendera". Il est possible que cet objet ait été offert par le roi à un de ses fonctionnaires enterré à Gebelein.

↑ , Scarabée avec ichneumon:
Scarabée avec ichneumon :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.06642
objectName :
objectTitle : Scarabée avec ichneumon
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 747 BC - 656 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 1,1 cm, Largeur: 0,7 cm, Profondeur: 0,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Le plat montre la plume d’autruche de la déesse Maât et un mangouste (ichneumon) au-dessous d’un disque solaire. L’interprétation de cette composition reste incertaine (elle réfère possiblement au dieu Amon). Elle est populaire sur les scarabées de la XXVème dynastie.

↑ , Fiole en verre:
Fiole en verre :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.06897a
objectName :
objectTitle : Fiole en verre
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 30 BC - AD 395
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 16 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : La fabrication du verre a connu une révolution au début de notre ère par l'invention du soufflage. Grâce à la canne du verrier, il était possible de créer des objets plus grands et formés de parois plus minces. Le verre de couleur disparaissait au profit du verre transparent. Les formes des objets étaient également plus variées. Cette fiole représente un bel exemple d'une forme de verre spéciale datant de la Période Romaine.
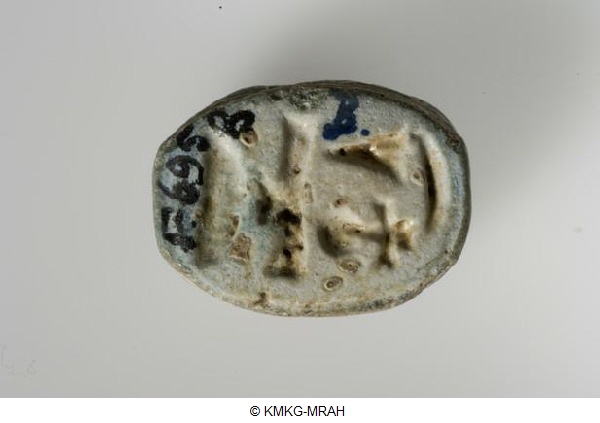
↑ , Scarabée:
Scarabée :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.06958b
objectName :
objectTitle : Scarabée
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : Inconnue
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 2,7 cm, Largeur: 2 cm, Profondeur: 1,3 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Le plat de ce scarabée porte une composition de hiéroglyphes ("nb", "Htp", "di" et "ânkh" ou "swt"(?)), rendus de façon inhabituelle. L'inscription réfère possiblement à la formule d'offerande, "Htp di nsw", 'l'offrande que donne le roi'. Fouille : Oxford Univ. 1933

↑ , Troupeau d'ânes en ivoire:
Troupeau d'ânes en ivoire :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.07066
objectName :
objectTitle : Troupeau d'ânes en ivoire
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 4000 BC - 3000 BC (Incertaine)
material :
technique :
dimensions :
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Cet ensemble de figurines en ivoire, qui faisait partie de la collection von Bissing et ensuite de la collection Lunsingh Scheurleer, se compose d'un troupeau de sept ânes. De dimension minuscule, ils varient de trois à quatre centimètres. Les pattes des animaux sont fort endommagées. La figurine représentant l'ânier du troupeau n'existe plus. Il est possible que les objets proviennent d'une tombe de la Période Prédynastique.

↑ , Empreinte de sceau:
Empreinte de sceau :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.07789
objectName :
objectTitle : Empreinte de sceau
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating :
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 62 mm, Largeur: 65 mm, Profondeur: 37 mm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Empreinte avec des signes clairement définis et, possible, des traces de la matière organique. Surface irrégulière avec trois empreintes. L'un d'eux, incurvé, pourrait être l'empreinte négative d'une petite corde ou d'un dispositif courbe. Un autre est rectiligne. Traces noirs identiques à celles sur l'avers se trouvent sur cette empreinte. Le dernier ne peut être identifié avec certitude.

↑ , Empreinte de sceau:
Empreinte de sceau :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.07799
objectName :
objectTitle : Empreinte de sceau
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating :
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 1 mm, Largeur: 80 mm, Profondeur: 1 mm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Type? Fragment d'empreinte. L'avers représente deux empreintes de sceaux partiels avec des signes bien lisibles. On trouve les traces des bords d'un sceau-cylindre. L'inverse a une surface irrégulière avec des traces possibles d'un peu de corde et un noeud sur la partie inférieure du fragment.

↑ , Fragment d’une frise de pampres de vigne:
Fragment d’une frise de pampres de vigne :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.08066
objectName :
objectTitle : Fragment d’une frise de pampres de vigne
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : AD 395 - AD 640
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 90 cm, Largeur: 35 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : En Égypte, durant l’Antiquité tardive, le langage iconographique et les textes classiques continuent à faire partie de la culture et de l’éducation des élites, même après que ces dernières se soient converties au christianisme. Certains bâtiments et certaines œuvres d’art présentent alors un surprenant mélange d’éléments empruntés à l’Antiquité classique et à l’Égypte ancienne. Les artistes ont en effet découvert qu’il est possible d’utiliser, dans un contexte chrétien, la représentation des dieux et des motifs ornementaux issus des traditions païennes. Dans la tradition gréco-romaine, le pampre de vigne est un des attributs du dieu du vin Dionysos, mais il est aussi utilisé comme motif purement décoratif. Durant la période paléo-chrétienne, il est utilisé comme symbole du Christ, en référence au passage biblique « Je suis la vigne, vous êtes les sarments » (Jean, XV, 5).

↑ , Fragment architectural avec feuilles d’acanthe et oiseaux s’abreuvant à une coupe:
Fragment architectural avec feuilles d’acanthe et oiseaux s’abreuvant à une coupe :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.08215
objectName :
objectTitle : Fragment architectural avec feuilles d’acanthe et oiseaux s’abreuvant à une coupe
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : AD 200 - AD 640
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 23 cm, Largeur: 53 cm, Profondeur: 9,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : En Égypte, durant l’Antiquité tardive, le langage iconographique et les textes classiques continuent à faire partie de la culture et de l’éducation des élites, même après que ces dernières se soient converties au christianisme. Certains bâtiments et certaines œuvres d’art présentent alors un surprenant mélange d’éléments empruntés à l’Antiquité classique et à l’Égypte ancienne. Les artistes ont en effet découvert qu’il est possible d’utiliser, dans un contexte chrétien, la représentation des dieux et des motifs ornementaux issus des traditions païennes. Les oiseaux buvant à la coupe, un motif très répandu dans l’art antique depuis l’époque hellénistique, pourraient évoquer la source de vie, ou, dans un contexte chrétien, faire allusion au Christ.

↑ , Frise à motifs végétaux entourant des animaux:
Frise à motifs végétaux entourant des animaux :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.08247
objectName :
objectTitle : Frise à motifs végétaux entourant des animaux
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : AD 395 - AD 640
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 27 cm, Largeur: 49,5 cm, Profondeur: 14 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : En Égypte, durant l’Antiquité tardive, le langage iconographique et les textes classiques continuent à faire partie de la culture et de l’éducation des élites, même après que ces dernières se soient converties au christianisme. Certains bâtiments et certaines œuvres d’art présentent alors un surprenant mélange d’éléments empruntés à l’Antiquité classique et à l’Égypte ancienne. Les artistes ont en effet découvert qu’il est possible d’utiliser, dans un contexte chrétien, la représentation des dieux et des motifs ornementaux issus des traditions païennes.

↑ , Dieu à tête de serpent:
Dieu à tête de serpent :
collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.08974
objectName :
objectTitle : Dieu à tête de serpent
objectCulture : Égyptienne
geography :
dating : 664 BC - 332 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 16,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Cette statuette en bronze figure un dieu-serpent sous son aspect anthropoïde. Le dieu est représenté debout, dans l'attitude de la marche, les poings serrés. La tête de serpent aux yeux saillants et soutenue par un cou enflé et courbé, est encadrée d'une perruque aux longues stries parallèles. Le dieu porte un pagne court, plissé, retenu au moyen d'une étroite ceinture. Il est possible que la statuette représente Heneb, divinité protectrice locale d'Héracléopolis Magna.

↑ , Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux':
Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux' :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0039
objectName :
objectTitle : Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux'
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 750 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 17 cm, Largeur: 5,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole, sans pied; Gilgamesh tenant deux gueules de lion; en dessous une tête de lion et deux têtes de coqs. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards, comme cat. 278 et 280, se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan et qui se retrouve, entre autres, aussi sur la garniture de carquois cat. 252. Les idoles cat. 281 et 282, parfois interprétées comme le « maître des animaux », représentent une phase suivante de l’évolution. Un personnage humain est figuré entre deux panthères dressées et affrontées. Les corps des fauves et celui de l’être humain sont soudés pour former un ensemble affectant la forme d’un tuyau, ce qui remplace la feuille de bronze enroulée de l’ancien type d’idole. La réalisation la plus complexe autour du thème du « maître des animaux » est illustrée par cat. 283 et 284. Ce sont maintenant respectivement deux et trois têtes humaines qui sont superposées, le personnage supérieur tenant les fauves par le cou, tandis que des têtes d’oiseaux et de petits volatiles sont ajoutés sur les croupes et cous des fauves. Les divers éléments anatomiques sont toujours plus déformés. Sur la pièce cat. 284, les griffes des fauves du bas sont quasi méconnaissables et les queues disparaissent en grande partie entre les pattes postérieures. Seule la pointe enroulée est encore nettement visible. C’est une idole aussi complexe que celle-là qui fut mise au jour par l’expédition belge à Tattulban. Elle se trouvait dans la tombe d’un homme du début de l’âge du Fer III (début du 8e siècle). La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Idole ou étendard:
Idole ou étendard :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0045
objectName :
objectTitle : Idole ou étendard
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : ca. 1180 BC - AD 300
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 11 cm, Largeur: 5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole ou étendard en bronze, deux lions debout. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan.

↑ , Support d'idole:
Support d'idole :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0067
objectName :
objectTitle : Support d'idole
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 750 BC
material :
technique :
dimensions : Dimensions H x D: 9 cm, 2,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Socle d'une idole ou étendard. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants.

↑ , Support d'idole:
Support d'idole :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0068
objectName :
objectTitle : Support d'idole
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : ca. 1180 BC - AD 300
material :
technique :
dimensions : Dimensions H x D: 8,2 cm, 3,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Support d'idole en bronze. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants.

↑ , Support d'idole:
Support d'idole :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0069
objectName :
objectTitle : Support d'idole
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : ca. 1180 BC - AD 300
material :
technique :
dimensions : Dimensions H x D: 17 cm, 4 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Socle d'une idole en bronze. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants.

↑ , Vase à bec verseur:
Vase à bec verseur :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0072
objectName :
objectTitle : Vase à bec verseur
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1000 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 10 cm, Largeur: 27 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Vase à bec ouvert, et protubérance circulaire, servant à décanter; la poche du décantage est entourée de 11 hémisphères et découée de lignes circulaires. Ce vase relève d’un type rencontré également en-dehors du Luristan, entre autres à Tepe Siyalk où de la vaisselle comparable a été découverte. Ayant été mis au jour sur plusieurs sites du Luristan, il est possible de les dater du 10e-9e siècle. Le bec verseur est fixé au récipient à l’aide de rivets à têtes semi-sphériques placés en couronne tout autour du col. Ce dernier est entièrement décoré d’un motif linéaire; dans des cas exceptionnels, il se termine en tête de lion. Des vases à col en forme de tête humaine ont été mis au jour à Sangtarashan, au Luristan, et sur l’île de Samos où il s’agit d’une pièce d’importation.

↑ , Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux':
Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux' :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0123
objectName :
objectTitle : Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux'
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : ca. 1180 BC - AD 300
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 19,8 cm, Largeur: 8 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole, sans pied. Gilgamesh tenant 2 gueules de lion. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants.

↑ , Idole ou étendard:
Idole ou étendard :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0124
objectName :
objectTitle : Idole ou étendard
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : ca. 1180 BC - AD 300
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 11,8 cm, Largeur: 5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan.

↑ , Idole ou étendard:
Idole ou étendard :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0125
objectName :
objectTitle : Idole ou étendard
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : ca. 1180 BC - AD 300
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 10 cm, Largeur: 4,8 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan.

↑ , Vase à bec verseur:
Vase à bec verseur :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0194
objectName :
objectTitle : Vase à bec verseur
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : ca. 1180 BC - AD 300
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 12,3 cm, Largeur: 12,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Ce vase relève d’un type rencontré également en dehors du Luristan, entre autres à Tepe Siyalk où de la vaisselle comparable a été découverte. Ayant été mis au jour sur plusieurs sites du Luristan, il est possible de les dater du 10e-9e siècle. Le bec verseur est fixé au récipient à l’aide de rivets à têtes semi-sphériques placés en couronne tout autour du col. Ce dernier est entièrement décoré d’un motif linéaire; dans des cas exceptionnels, il se termine en tête de lion. Des vases à col en forme de tête humaine ont été mis au jour à Sangtarashan, au Luristan, et sur l’île de Samos où il s’agit d’une pièce d’importation.

↑ , Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux':
Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux' :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0328
objectName :
objectTitle : Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux'
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 13 cm, Largeur: 7 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole. Sur deux croupes de quadrupèdes réunies, se dresse le buste à tête humaine (?); des épaules se détachent deux longs cous dont les gueules saissent d'énormes oreilles de la tête humaine. Nez en lame; yeux protubérants; de chaque côté du buste, on voit 4 et 5 traits en relief, qui font penser à la figuration de doigts. Autour du buste, 3 cerches en relief. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. Les idoles parfois interprétées comme le « maître des animaux », représentent une phase suivante de l’évolution. Un personnage humain est figuré entre deux panthères dressées et affrontées. Les corps des fauves et celui de l’être humain sont soudés pour former un ensemble affectant la forme d’un tuyau, ce qui remplace la feuille de bronze enroulée de l’ancien type d’idole. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Idole ou étendard:
Idole ou étendard :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0609
objectName :
objectTitle : Idole ou étendard
objectCulture : Culture inconnue
geography :
dating : 1300 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 10,5 cm, Largeur: 9 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole funéraire. Deux bouquetins dressés debout face à face, s'appuyant de la poitrine à l'anneau dans lequel devait passer l'épingle. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Idole en bronze:
Idole en bronze :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0610
objectName :
objectTitle : Idole en bronze
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 750 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 35 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole funéraire, à double face. Deux bouquetins dressés s'affrontant. Les pattes avant s'appliquent sur un anneau dans lequel passe le tube de l'épingle. Il est surmonté d'une partie ovale, composée de quatre bandes rayées, qui s'unissent dans le haut. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Idole ou étendard:
Idole ou étendard :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0611
objectName :
objectTitle : Idole ou étendard
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 750 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 13 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole funéraire à double face. Deux animaux féroces dressés debout face à face. Ils se touchent avec les pattes avant et arrière. Grandes têtes à gueule ouverte, cous longs. Queues pendantes, un peu recourbées. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Idole ou étendard:
Idole ou étendard :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0613
objectName :
objectTitle : Idole ou étendard
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 8,5 cm, Largeur: 4 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole funéraire. Deux animaux féroces dressés debout face à face. Les pattes avant et arrière se touchent, gueules ouvertes. Queues pendantes, un peu recourbées. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Idole ou étendard:
Idole ou étendard :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0615
objectName :
objectTitle : Idole ou étendard
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 750 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 15,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole funéraire à double face. Deux animaux féroces aux corps graciles, sont affrontés. Le tube de l'épingle passe par deux animaux tenus par les pattes avant et les pattes arrières. Les cous longs s'élèvent en arc de cercle; les têtes à gueule ouverte et lange allongée. Queues pendantes, un peu recourbées. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Idole ou étendard:
Idole ou étendard :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0616
objectName :
objectTitle : Idole ou étendard
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 17,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole funéraire. Personnage féminin. Corps allongé à tête triangulaire. Coiffure ronde, deux pointes derrière la tête. Autour du cou un collier. Deux têtes d'oiseaux aux épaules. Ebauches des mains entourant les seins. La taille et les hanches sont enveloppées par des bandes. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. Un certain nombre de petites sculptures ne combinent que quelques-unes des caractéristiques des idoles à celles des statuettes humaines. Elles sont entièrement perforées, mais leurs faces antérieure et postérieure ne sont plus identiques. Ici, seules la perforation verticale et les deux têtes de coqs émanant des épaules font encore allusion au thème du « maître des animaux ». La datation de ces statuettes est problématique. Comme les idoles dites du « maître des animaux », elles étaient vraisemblablement en usage au cours des 10e-9e siècles, voire encore au 8e siècle. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Idole en bronze:
Idole en bronze :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0618
objectName :
objectTitle : Idole en bronze
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 13,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole funéraire. Deux bouquetins dressés s'affrontant, les pattes de devant reposant usur l'anneau qui devait contenir le tuyau. La queue en torsade. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Idole ou étendard:
Idole ou étendard :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0619
objectName :
objectTitle : Idole ou étendard
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 8,5 cm, Largeur: 3 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole funéraire à double face. Le torse est triangulaire; les bras indiqués par rainures, les mains ramenées entre les cuisses. Le bas est formé par les arrière-trains de deux animaux formant hanches, la queue pendante. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. Un certain nombre de petites sculptures ne combinent que quelques-unes des caractéristiques des idoles à celles des statuettes humaines. Elles sont entièrement perforées, mais leurs faces antérieure et postérieure ne sont plus identiques. Ici, l'idole se compose de la partie inférieure du corps de fauves et de la partie supérieure d’une femme tenant les mains devant son sexe. La datation de ces statuettes est problématique. Comme les idoles dites du « maître des animaux », elles étaient vraisemblablement en usage au cours des 10e-9e siècles, voire encore au 8e siècle. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Idole ou étendard:
Idole ou étendard :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0620
objectName :
objectTitle : Idole ou étendard
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 9 cm, Largeur: 2,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole funéraire à double face. Personnage masculin. Torse en forme de cylindre, les bras repliés, les mains sur la poitrine. Le cou et la taille sont entourés de bandes en relief. Deux fauves forment la partie inférieure de la statuette, leurs corps liés par des ligatures. Queues retournées au bas. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. Un certain nombre de petites sculptures ne combinent que quelques-unes des caractéristiques des idoles à celles des statuettes humaines. Elles sont entièrement perforées, mais leurs faces antérieure et postérieure ne sont plus identiques. Dans ce cas, deux petits fauves sont couchés et étirés le long de la partie inférieure du corps en forme de tuyau. La datation de ces statuettes est problématique. Comme les idoles dites du « maître des animaux », elles étaient vraisemblablement en usage au cours des 10e-9e siècles, voire encore au 8e siècle. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Idole ou étendard:
Idole ou étendard :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0621
objectName :
objectTitle : Idole ou étendard
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 14,5 cm, Largeur: 6 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole funéraire à double face. Deux animaux fantastiques dressés deboutface à face. Ils se touchent avec les pattes avant et arrière. Têtes curieuses et plates avec crête et long museau. Cous longs et légèrement courbés. Queues pendantes, un peu recourbées. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants.

↑ , Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux':
Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux' :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0622
objectName :
objectTitle : Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux'
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 15 cm, Largeur: 7,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole funéraire à double face. Torse long en forme cylindrique. Tête triangulaire à coiffure ronde. A la place des bras, deux têtes de panthères fantastiques à longs cous courbés. Au bas les parties postérieures d'un quadrupède à queue pendante, recourbée. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. Les idoles parfois interprétées comme le « maître des animaux », représentent une phase suivante de l’évolution. Un personnage humain est figuré entre deux panthères dressées et affrontées. Les corps des fauves et celui de l’être humain sont soudés pour former un ensemble affectant la forme d’un tuyau, ce qui remplace la feuille de bronze enroulée de l’ancien type d’idole. Un certain nombre de petites sculptures ne combinent que quelques-unes des caractéristiques des idoles à celles des statuettes humaines. Elles sont entièrement perforées, mais leurs faces antérieure et postérieure ne sont plus identiques. Dans le cas de cat. 287, deux petits fauves sont couchés et étirés le long de la partie inférieure du corps en forme de tuyau. Pour sa part, cat. 285 se compose de la partie inférieure du corps de fauves et de la partie supérieure d’une femme tenant les mains devant son sexe. En ce qui concerne cat. 286, seules la perforation verticale et les deux têtes de coqs émanant des épaules font encore allusion au thème du « maître des animaux ». La datation de ces statuettes est problématique. Comme les idoles dites du « maître des animaux », elles étaient vraisemblablement en usage au cours des 10e-9e siècles, voire encore au 8e siècle. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux':
Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux' :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0624
objectName :
objectTitle : Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux'
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 36 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Idole funéraire à double face. Trois têtes humaines sont superposées. De chaque côté et sous la deuxième tête partent des cous de dragons, les têtes à côté du personnage supérieur qui les tient avec ses bras. Sous le cou des dragons, têtes d'oiseaux. Le milieu du corps est formé par la troisième tête à barbe en collier. La partie basse est formée par les arrière-trains stylisés d'animaux, ornés d'un rang de petites globules. De la partie saillante sortent deux têtes d'oiseaux avec crête et anneaux autour du cou. Le bas se termine en queue de poisson. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. Les idoles parfois interprétées comme le « maître des animaux », représentent une phase suivante de l’évolution. La réalisation la plus complexe autour du thème du « maître des animaux » est illustrée ici. Ce sont maintenant trois têtes humaines qui sont superposées, le personnage supérieur tenant les fauves par le cou, tandis que des têtes d’oiseaux et de petits volatiles sont ajoutés sur les croupes et cous des fauves. Les divers éléments anatomiques sont toujours plus déformés. Les griffes des fauves du bas sont quasi méconnaissables et les queues disparaissent en grande partie entre les pattes postérieures. Seule la pointe enroulée est encore nettement visible. C’est une idole aussi complexe que celle-là qui fut mise au jour par l’expédition belge à Tattulban. Elle se trouvait dans la tombe d’un homme du début de l’âge du Fer III (début du 8e siècle). La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux':
Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux' :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0625
objectName :
objectTitle : Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux'
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 27 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Statuette funéraire à double face. Dans le haut, masque humain reposant sur les bras repliés et détachés qui forment colonne de support. Des deux côtés cou et tête d'animal fabuleux (dragon), gueule ouverte à la hauteur du sommet de la tête humaine. Bouton en forme de poire. Autour de la taille une espèce de ceinture très large à rayures verticales. Au bas les parties postérieures d'un quadrupède. Les hanches sont arrondies, les pattes se terminent par des espèces de nageoires de poisson. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan. Les idoles parfois interprétées comme le « maître des animaux », représentent une phase suivante de l’évolution. La réalisation la plus complexe autour du thème du « maître des animaux » est illustrée ici. Ce sont maintenant deux têtes humaines qui sont superposées, le personnage supérieur tenant les fauves par le cou, tandis que des têtes d’oiseaux et de petits volatiles sont ajoutés sur les croupes et cous des fauves. Les divers éléments anatomiques sont toujours plus déformés. C’est une idole aussi complexe que celle-là qui fut mise au jour par l’expédition belge à Tattulban. Elle se trouvait dans la tombe d’un homme du début de l’âge du Fer III (début du 8e siècle). La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Cruche à long bec verseur:
Cruche à long bec verseur :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0818
objectName :
objectTitle : Cruche à long bec verseur
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1000 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Dimensions H x D: 11,5 cm, 28 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Vase liturgique à long bec. Corps globuleux dont le col manque. Seule la partie postérieure de l'anse subsiste. Le décantoir est en forme de tête de lion et est entouré de grosses globules. Ce vase relève d’un type rencontré également en-dehors du Luristan, entre autres à Tepe Siyalk où de la vaisselle comparable a été découverte. Ayant été mis au jour sur plusieurs sites du Luristan, il est possible de les dater du 10e-9e siècle. Le bec verseur est fixé au récipient à l’aide de rivets à têtes semi-sphériques placés en couronne tout autour du col. Ce dernier se termine en tête de lion. Des vases à col en forme de tête humaine ont été mis au jour à Sangtarashan, au Luristan, et sur l’île de Samos où il s’agit d’une pièce d’importation.
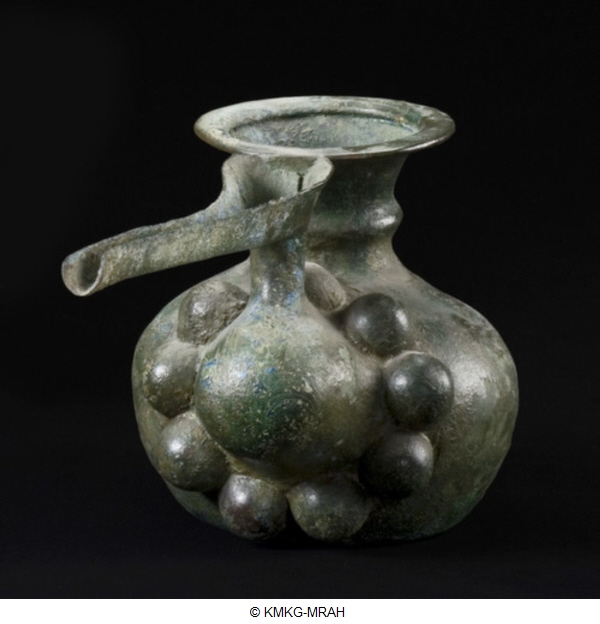
↑ , Vase à long bec verseur:
Vase à long bec verseur :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0822
objectName :
objectTitle : Vase à long bec verseur
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1000 BC - 801 BC
material :
technique :
dimensions : Dimensions H x D: 10,5 cm, 25 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Grand vase liturgique avec long bec et décantoir. Corps globuleux à col étroit en forme cylindrique. Le bord est plat et fortement saillant. Le déversoir est entouré de grosses globules. e vase relève d’un type rencontré également en-dehors du Luristan, entre autres à Tepe Siyalk où de la vaisselle comparable a été découverte. Ayant été mis au jour sur plusieurs sites du Luristan, il est possible de les dater du 10e-9e siècle. Le bec verseur est fixé au récipient à l’aide de rivets à têtes semi-sphériques placés en couronne tout autour du col. Ce dernier est entièrement décoré d’un motif linéaire; dans des cas exceptionnels, il se termine en tête de lion. Des vases à col en forme de tête humaine ont été mis au jour à Sangtarashan, au Luristan, et sur l’île de Samos où il s’agit d’une pièce d’importation.
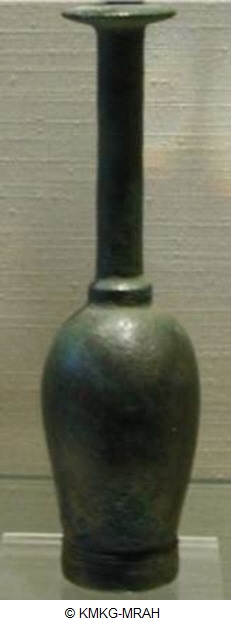
↑ , Support d'idole:
Support d'idole :
collectionName : IraninventoryNb : IR.0846
objectName :
objectTitle : Support d'idole
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 1300 BC - 750 BC
material :
technique :
dimensions : Dimensions H x D: 16 cm, 4,2 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Support, en forme de bouteille sans fond; col très long. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Fragment de cuve funéraire:
Fragment de cuve funéraire :
collectionName : IraninventoryNb : IR.1093
objectName :
objectTitle : Fragment de cuve funéraire
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 800 BC - 601 BC
material :
technique :
dimensions :
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Ces quatre fragments (IR.1093-IR.1096) faisaient partie d’une cuve en bronze. Des cuves similaires, à fond plat, aux parois verticales et à bord supérieur large et horizontal, ont été découverts au cours de fouilles menées dans le Nord de la Syrie, en Mésopotamie et en Élam (Arjan et Ram Hormuz). Elles étaient constituées de grandes plaques de bronze rivetées les unes aux autres par de larges bandeaux. Ces quatre fragments proviennent d’une cuve qui aurait été découverte par hasard en 1946 à Ziwiyeh, dans le Kurdistan. Il s’agissait d’une tombe contenant des objets en métaux précieux et en ivoire, qui présentent des caractères stylistiques tant assyriens, qu’urartéen, scythes et mèdes. Il est possible que cela soit représentatif du royaume local mannéen encore méconnu au niveau archéologique. Par l’intermédiaire du commerce de l’art, les découvertes de Ziwiyeh ont été dispersées dans nombre de musées et de collections. Le nom populaire de Ziwiyeh est fréquemment donné à tort comme lieu de trouvaille pour des objets issus du commerce de l’art. Des fragments de la même cuve en bronze sont conservés à l’Iran Bastan Museum de Téhéran, au Metropolitan Museum of Art de New York, au Seattle Art Museum et au Musée Cernuschi à Paris. Sur les fragments du bord supérieur a été gravée une rangée de porteurs de tributs de style assyrien. Les plaques rectangulaires sont des fragments des bandes verticales grâce auxquelles les plaques étaient rivetées les unes aux autres. Le décor composé de chèvres posées sur une rosette est identique à celui d’une cuve exhumée à Ur. B.O.

↑ , Fragment de cuve funéraire:
Fragment de cuve funéraire :
collectionName : IraninventoryNb : IR.1094
objectName :
objectTitle : Fragment de cuve funéraire
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 800 BC - 601 BC
material :
technique :
dimensions :
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Ces quatre fragments (IR.1093-IR.1096) faisaient partie d’une cuve en bronze. Des cuves similaires, à fond plat, aux parois verticales et à bord supérieur large et horizontal, ont été découverts au cours de fouilles menées dans le Nord de la Syrie, en Mésopotamie et en Élam (Arjan et Ram Hormuz). Elles étaient constituées de grandes plaques de bronze rivetées les unes aux autres par de larges bandeaux. Ces quatre fragments proviennent d’une cuve qui aurait été découverte par hasard en 1946 à Ziwiyeh, dans le Kurdistan. Il s’agissait d’une tombe contenant des objets en métaux précieux et en ivoire, qui présentent des caractères stylistiques tant assyriens, qu’urartéen, scythes et mèdes. Il est possible que cela soit représentatif du royaume local mannéen encore méconnu au niveau archéologique. Par l’intermédiaire du commerce de l’art, les découvertes de Ziwiyeh ont été dispersées dans nombre de musées et de collections. Le nom populaire de Ziwiyeh est fréquemment donné à tort comme lieu de trouvaille pour des objets issus du commerce de l’art. Des fragments de la même cuve en bronze sont conservés à l’Iran Bastan Museum de Téhéran, au Metropolitan Museum of Art de New York, au Seattle Art Museum et au Musée Cernuschi à Paris. Sur les fragments du bord supérieur a été gravée une rangée de porteurs de tributs de style assyrien. Les plaques rectangulaires sont des fragments des bandes verticales grâce auxquelles les plaques étaient rivetées les unes aux autres. Le décor composé de chèvres posées sur une rosette est identique à celui d’une cuve exhumée à Ur. B.O.

↑ , Fragment de cuve funéraire:
Fragment de cuve funéraire :
collectionName : IraninventoryNb : IR.1095
objectName :
objectTitle : Fragment de cuve funéraire
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 800 BC - 601 BC
material :
technique :
dimensions :
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Ces quatre fragments (IR.1093-IR.1096) faisaient partie d’une cuve en bronze. Des cuves similaires, à fond plat, aux parois verticales et à bord supérieur large et horizontal, ont été découverts au cours de fouilles menées dans le Nord de la Syrie, en Mésopotamie et en Élam (Arjan et Ram Hormuz). Elles étaient constituées de grandes plaques de bronze rivetées les unes aux autres par de larges bandeaux. Ces quatre fragments proviennent d’une cuve qui aurait été découverte par hasard en 1946 à Ziwiyeh, dans le Kurdistan. Il s’agissait d’une tombe contenant des objets en métaux précieux et en ivoire, qui présentent des caractères stylistiques tant assyriens, qu’urartéen, scythes et mèdes. Il est possible que cela soit représentatif du royaume local mannéen encore méconnu au niveau archéologique. Par l’intermédiaire du commerce de l’art, les découvertes de Ziwiyeh ont été dispersées dans nombre de musées et de collections. Le nom populaire de Ziwiyeh est fréquemment donné à tort comme lieu de trouvaille pour des objets issus du commerce de l’art. Des fragments de la même cuve en bronze sont conservés à l’Iran Bastan Museum de Téhéran, au Metropolitan Museum of Art de New York, au Seattle Art Museum et au Musée Cernuschi à Paris. Sur les fragments du bord supérieur a été gravée une rangée de porteurs de tributs de style assyrien. Les plaques rectangulaires sont des fragments des bandes verticales grâce auxquelles les plaques étaient rivetées les unes aux autres. Le décor composé de chèvres posées sur une rosette est identique à celui d’une cuve exhumée à Ur. B.O.
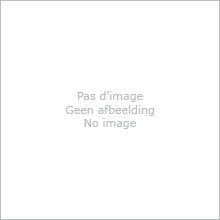
↑ , Fragment de cuve funéraire:
Fragment de cuve funéraire :
collectionName : IraninventoryNb : IR.1096
objectName :
objectTitle : Fragment de cuve funéraire
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 800 BC - 601 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 13 cm, Largeur: 9,3 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Fragment du montant d'une cuve, Partie inférieure d'une plaque rectangulaire; rivets; décor gravé: bouquetins debout sur une rosace/ Ces quatre fragments (IR.1093-IR.1096) faisaient partie d’une cuve en bronze. Des cuves similaires, à fond plat, aux parois verticales et à bord supérieur large et horizontal, ont été découverts au cours de fouilles menées dans le Nord de la Syrie, en Mésopotamie et en Élam (Arjan et Ram Hormuz). Elles étaient constituées de grandes plaques de bronze rivetées les unes aux autres par de larges bandeaux. Ces quatre fragments proviennent d’une cuve qui aurait été découverte par hasard en 1946 à Ziwiyeh, dans le Kurdistan. Il s’agissait d’une tombe contenant des objets en métaux précieux et en ivoire, qui présentent des caractères stylistiques tant assyriens, qu’urartéen, scythes et mèdes. Il est possible que cela soit représentatif du royaume local mannéen encore méconnu au niveau archéologique. Par l’intermédiaire du commerce de l’art, les découvertes de Ziwiyeh ont été dispersées dans nombre de musées et de collections. Le nom populaire de Ziwiyeh est fréquemment donné à tort comme lieu de trouvaille pour des objets issus du commerce de l’art. Des fragments de la même cuve en bronze sont conservés à l’Iran Bastan Museum de Téhéran, au Metropolitan Museum of Art de New York, au Seattle Art Museum et au Musée Cernuschi à Paris. Sur les fragments du bord supérieur a été gravée une rangée de porteurs de tributs de style assyrien. Les plaques rectangulaires sont des fragments des bandes verticales grâce auxquelles les plaques étaient rivetées les unes aux autres. Le décor composé de chèvres posées sur une rosette est identique à celui d’une cuve exhumée à Ur. B.O.

↑ , Pendentif avec grelot:
Pendentif avec grelot :
collectionName : IraninventoryNb : IR.1097
objectName :
objectTitle : Pendentif avec grelot
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : 800 BC - 601 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 6 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Grelot avec chainette, grelot contenant une pierre, chainette avec pendentifs/ Ces quatre fragments faisaient partie d’une cuve en bronze. Des cuves similaires, à fond plat, aux parois verticales et à bord supérieur large et horizontal, ont été découverts au cours de fouilles menées dans le Nord de la Syrie, en Mésopotamie et en Élam (Arjan et Ram Hormuz). Elles étaient constituées de grandes plaques de bronze rivetées les unes aux autres par de larges bandeaux. Ces quatre fragments proviennent d’une cuve qui aurait été découverte par hasard en 1946 à Ziwiyeh, dans le Kurdistan. Il s’agissait d’une tombe contenant des objets en métaux précieux et en ivoire, qui présentent des caractères stylistiques tant assyriens, qu’urartéen, scythes et mèdes (voir aussi cat. 216-220). Il est possible que cela soit représentatif du royaume local mannéen encore méconnu au niveau archéologique. Par l’intermédiaire du commerce de l’art, les découvertes de Ziwiyeh ont été dispersées dans nombre de musées et de collections. Le nom populaire de Ziwiyeh est fréquemment donné à tort comme lieu de trouvaille pour des objets issus du commerce de l’art. Des fragments de la même cuve en bronze sont conservés à l’Iran Bastan Museum de Téhéran, au Metropolitan Museum of Art de New York, au Seattle Art Museum et au Musée Cernuschi à Paris. Sur les fragments du bord supérieur (cat. 212-213) a été gravée une rangée de porteurs de tributs de style assyrien. Les plaques rectangulaires (cat. 214-215) sont des fragments des bandes verticales grâce auxquelles les plaques étaient rivetées les unes aux autres. Le décor composé de chèvres posées sur une rosette est identique à celui d’une cuve exhumée à Ur. B.O.

↑ , Casque:
Casque :
collectionName : IraninventoryNb : IR.1315
objectName :
objectTitle : Casque
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : ca. AD 591 - AD 610
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 21,7 cm, Largeur: 22,3 cm, Profondeur: 19,1 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Ce casque est fait de bandes de fer recouvertes de plaques de bronze entre lesquelles sont rivetées des plaques de fer recouvertes de plaques d’argent. À l’origine, des mailles étaient fixées dans la partie inférieure. L’ensemble est décoré de motifs d’écailles ou de plumes. Devant, sur le bandeau frontal, apparaît un croissant de lune posé sur un socle. Le choix des matériaux et des motifs indique qu’il s’agit d’un objet de prestige qui reflète le rôle militaire et social du propriétaire. Le casque aurait été trouvé dans une tombe, en même temps que la chaise pliante. On connaît un certain nombre de poignards, d’épées et de casques portant un décor de plumes similaire apposé sur des plaques d’argent ou d’or. Ils seraient tous originaires du Nord de l’Iran. Tous les casques sont d’ailleurs ornés d’un croissant de lune sur le bandeau frontal. Il est possible que les plumes se réfèrent à l’oiseau mythique Varagna qui, selon la doctrine zoroastrienne, serait une incarnation de Verethragna, le dieu de la victoire. Des motifs en écailles comparables, appliqués sur des feuilles d’or et d’argent, sont très répandus en Eurasie et apparaissent déjà sur l’armement des Huns à partir du 5e siècle. Le type de casque est apparenté aux armures de tête appelées « Baldenheimer » façonnés dans des ateliers byzantins et ostrogoths. B.O
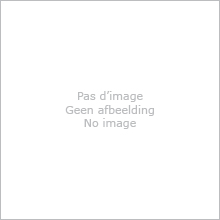
↑ , Chaise pliante:
Chaise pliante :
collectionName : IraninventoryNb : IR.1316
objectName :
objectTitle : Chaise pliante
objectCulture : Iranienne
geography :
dating : AD 550 - AD 650
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 56 cm, Largeur: 38,7 cm, Profondeur: 37,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Cette chaise pliante est constituée de deux cadres rectangulaires et de deux barres en fer pourvues d’anneaux destinés à attacher le siège. Les cadres sont quadrangulaires aux angles et octogonaux au centre. Toutes les parties visibles de la chaise sont damasquinées de motifs géométriques et floraux en laiton et en argent. La chaise aurait été trouvée en même temps que le casque. Des sièges de ce genre ont été découverts dans des tombes avares de Hongrie et dans des sépultures lombardes à Nocera Umbra, en Italie. Ces dernières sont quasi identiques et sont probablement issues du même atelier. Des mercenaires lombards combattirent, entre autres en 553, aux côtés de l’armée byzantine contre les Sassanides. Il est possible que cette chaise ait fait partie d’un butin de guerre ou qu’elle ait été offerte. Rien que la richesse de la décoration prouve l’importance des chaises pliantes de ce type. Elles sont connues sous le nom de sella castrensis et sont la version militaire de la sella curulis romaine, un genre de siège réservé aux fonctionnaires romains du plus haut rang. Ce rapport entre le statut et l’usage d’une chaise pliante, à l’origine établi par les Romains, a perduré jusque dans la faldistorium, le siège épiscopal de l’Église catholique romaine. B.O.

↑ , Stèle funéraire de Makki ibn al-Hassan ibn Musa (Makki, fils de al-Hassan, fils de Musa):
Stèle funéraire de Makki ibn al-Hassan ibn Musa (Makki, fils de al-Hassan, fils de Musa) :
collectionName : Art du monde islamiqueinventoryNb : IS.O.0505
objectName :
objectTitle : Stèle funéraire de Makki ibn al-Hassan ibn Musa (Makki, fils de al-Hassan, fils de Musa)
objectCulture : Islamique
geography :
dating : AD 829
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 42,8 cm, Largeur: 48 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Avec la diffusion de l'islam, les coutumes funéraires égyptiennes changent. Une tombe se doit d'être aussi sobre que possible pour éviter le culte des morts. Cette injonction n'est cependant pas toujours suivie. L'inscription de cette stèle funéraire souligne le réconfort qu'offre Allah au défunt et à ses proches. La mort du prophète Muhammad est présentée comme le plus grand malheur de tous les temps. Le défunt est présenté sous son nom comme témoin, puis vient sa profession de foi. On se souviendra ainsi qu'il était croyant et espérait ressusciter, comme le promet le Coran.

↑ , Shiika shashinkyō (Vrai miroir de poèmes chinois et japonais): Evocation d'un poème de Sei Shōnagon (Sei Shōnagon):
Shiika shashinkyō (Vrai miroir de poèmes chinois et japonais): Evocation d'un poème de Sei Shōnagon (Sei Shōnagon) :
collectionName : JaponinventoryNb : JP.03249
objectName :
objectTitle : Shiika shashinkyō (Vrai miroir de poèmes chinois et japonais): Evocation d'un poème de Sei Shōnagon (Sei Shōnagon)
objectCulture :
geography :
dating : ca. AD 1833 - AD 1834
material :
technique :
dimensions : Dimensions H x Lo: 50,7 cm, 22,7 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Sei Shōnagon (965 ? – 1020 env.) est l’une des grandes figures littéraires de l’époque de Heian (794-1185); dame de la cour impériale, elle se rendit célèbre comme essayiste et poétesse. Les éléments essentiels de cette composition sinisante sont : un homme scrutant l’horizon du haut d’un arbre, deux gardes s’affairant à ouvrir un portail et sur un mur, un coq en train de chanter. Le poème de Sei Shōnagon, auquel se réfère ici Hokusai, fait allusion à un épisode de la vie de Mengchang, un grand conseiller de l’État de Qi, à l’époque des Royaumes Combattants (fin Ve s. av. JC – 221 av. JC). Se sachant menacé d’une mort imminente par le roi de Qin, Mengchang prit la fuite aussi vite que possible. Mais dans sa course, il se trouva arrêté à la barrière de la passe de Hangu - fermée qu’elle était durant la nuit, jusqu’au chant du coq. Mengchang recourut alors au stratagème de contrefaire le chant du coq : aussitôt tous les coqs du voisinage le reprirent en chœur et les gardes ouvrirent la barrière. C’est ainsi que Mengchang échappa à ses poursuivants.

↑ , :
:
collectionName : Instruments africainsinventoryNb : KUM0042
objectName :
objectTitle :
objectCulture : Gusii
geography :
dating : AD 2015
material :
technique :
dimensions :
legalRightOwner : Kenyatta University - Department of Music and Dance
objectDescription : "Large lyre, created by Dominic Ogari, as a base version of the Obokano. The sound box is a carved out log. Twelve nylon strings, in yellow, red, blue and green. Five small sticks glued horizontally together form the bridge. The rikano is three obokano in one. Three different tunings are possible, to play three different kinds of repertory. When the player is not singing, he can change the tunings during the performance. Played during dance performance, single or when entertaining people. There are only two versions up til now : one in California (Los Angeles), one in Nairobi. "Ri" is the Abagusii word for Giant" (Valentine Kihuha, Music department, Kenyatta University, 23 November 2018)

↑ , :
:
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.03411
objectName :
objectTitle :
objectCulture : Asie antérieure
geography :
dating : 1450 BC - 1200 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 10,3 cm, Largeur: 8,4 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Cette statuette représente un quadrupède bicéphale. Le bas de la patte arrière droite manque. Le corps de l’animal est gravé d’incisions. Les deux têtes sont coiffées de bonnets à deux cornes. Cet objet éventuellement cultuel est assez unique. Sa datation reste difficile à établir, notamment en raison du manque d’informations relatives au contexte archéologique. L’inspiration anatolienne semble évidente en raison de la bicéphalité de l’animal; celle-ci est récurrente à la période hittite impériale: évoquons le canard à deux têtes retrouvé à Hattusa, la capitale hittite (14e siècle) ou les nombreuses attestations de l’aigle bicéphale (symbole possible d’une dignité) sur les sceaux ou sur certains reliefs. R.L.

↑ , Statuette votive d'orant:
Statuette votive d'orant :
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.04569
objectName :
objectTitle : Statuette votive d'orant
objectCulture : Phénicienne
geography :
dating : 800 BC - 301 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 27 cm, Largeur: 5,9 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Après une tempête en mer qui eut lieu dans les années soixante, plusieurs statuettes en terre cuite échouèrent sur la plage aux environs de la ville de Tyr et mirent des plongeurs amateurs sur la piste de la cargaison d’une ou de plusieurs épaves de bateaux chargés de statuettes votives. Le nombre de ces statuettes, qui envahirent ensuite le marché de l’art, est de l’ordre du millier d’exemplaires. Elles représentent des orants et des orantes posés sur des socles parfois décorés de coupes d’offrandes et/ou de symboles tels que des dauphins, des ancres ou le signe dit de Tanit. Il est possible que les offrandes des sanctuaires très fréquentés de Tyr étaient régulièrement évacuées et, par manque de place sur la petite île qui abritait la ville, rituellement dispersées –comme pour une tombe de marin– en les chargeant dans de vieux navires qui étaient alors coulés en pleine mer. Vu les quantités, la théorie d’une telle favissa maritime semble plus plausible que celle d’un bateau chargés d’objets religieux ayant fait naufrage, par exemple en cinglant vers Carthage. Des statuettes de ce type sont toujours inconnues dans le monde punique ou même dans l’île de Chypre tout proche. Bien que la plupart d’entre elles remontent à la période perse, quelques-unes sont archaïques. C’est le cas de la représentation d’une musicienne voilée jouant de la lyre et datée du 8e siècle, un type par ailleurs attesté par une statuette en bronze provenant de Tyr et actuellement conservée à Copenhague. E.G.

↑ , Statuette votive d'orant:
Statuette votive d'orant :
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.04595
objectName :
objectTitle : Statuette votive d'orant
objectCulture : Phénicienne
geography :
dating : 800 BC - 301 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 16,1 cm, Largeur: 3,7 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Après une tempête en mer qui eut lieu dans les années soixante, plusieurs statuettes en terre cuite échouèrent sur la plage aux environs de la ville de Tyr et mirent des plongeurs amateurs sur la piste de la cargaison d’une ou de plusieurs épaves de bateaux chargés de statuettes votives. Le nombre de ces statuettes, qui envahirent ensuite le marché de l’art, est de l’ordre du millier d’exemplaires. Elles représentent des orants et des orantes posés sur des socles parfois décorés de coupes d’offrandes et/ou de symboles tels que des dauphins, des ancres ou le signe dit de Tanit. Il est possible que les offrandes des sanctuaires très fréquentés de Tyr étaient régulièrement évacuées et, par manque de place sur la petite île qui abritait la ville, rituellement dispersées –comme pour une tombe de marin– en les chargeant dans de vieux navires qui étaient alors coulés en pleine mer. Vu les quantités, la théorie d’une telle favissa maritime semble plus plausible que celle d’un bateau chargés d’objets religieux ayant fait naufrage, par exemple en cinglant vers Carthage. Des statuettes de ce type sont toujours inconnues dans le monde punique ou même dans l’île de Chypre tout proche. Bien que la plupart d’entre elles remontent à la période perse, quelques-unes sont archaïques. C’est le cas de la représentation d’une musicienne voilée jouant de la lyre et datée du 8e siècle, un type par ailleurs attesté par une statuette en bronze provenant de Tyr et actuellement conservée à Copenhague. E.G.

↑ , Statuette votive d'orant:
Statuette votive d'orant :
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.04596
objectName :
objectTitle : Statuette votive d'orant
objectCulture : Phénicienne
geography :
dating : 800 BC - 301 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 18,3 cm, Largeur: 5,7 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Après une tempête en mer qui eut lieu dans les années soixante, plusieurs statuettes en terre cuite échouèrent sur la plage aux environs de la ville de Tyr et mirent des plongeurs amateurs sur la piste de la cargaison d’une ou de plusieurs épaves de bateaux chargés de statuettes votives. Le nombre de ces statuettes, qui envahirent ensuite le marché de l’art, est de l’ordre du millier d’exemplaires. Elles représentent des orants et des orantes posés sur des socles parfois décorés de coupes d’offrandes et/ou de symboles tels que des dauphins, des ancres ou le signe dit de Tanit. Il est possible que les offrandes des sanctuaires très fréquentés de Tyr étaient régulièrement évacuées et, par manque de place sur la petite île qui abritait la ville, rituellement dispersées –comme pour une tombe de marin– en les chargeant dans de vieux navires qui étaient alors coulés en pleine mer. Vu les quantités, la théorie d’une telle favissa maritime semble plus plausible que celle d’un bateau chargés d’objets religieux ayant fait naufrage, par exemple en cinglant vers Carthage. Des statuettes de ce type sont toujours inconnues dans le monde punique ou même dans l’île de Chypre tout proche. Bien que la plupart d’entre elles remontent à la période perse, quelques-unes sont archaïques. C’est le cas de la représentation d’une musicienne voilée jouant de la lyre et datée du 8e siècle, un type par ailleurs attesté par une statuette en bronze provenant de Tyr et actuellement conservée à Copenhague. E.G.

↑ , Statuette votive d'orant:
Statuette votive d'orant :
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.04597
objectName :
objectTitle : Statuette votive d'orant
objectCulture : Phénicienne
geography :
dating : 800 BC - 301 BC Inconnue
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 18,5 cm, Largeur: 4,8 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Après une tempête en mer qui eut lieu dans les années soixante, plusieurs statuettes en terre cuite échouèrent sur la plage aux environs de la ville de Tyr et mirent des plongeurs amateurs sur la piste de la cargaison d’une ou de plusieurs épaves de bateaux chargés de statuettes votives. Le nombre de ces statuettes, qui envahirent ensuite le marché de l’art, est de l’ordre du millier d’exemplaires. Elles représentent des orants et des orantes posés sur des socles parfois décorés de coupes d’offrandes et/ou de symboles tels que des dauphins, des ancres ou le signe dit de Tanit. Il est possible que les offrandes des sanctuaires très fréquentés de Tyr étaient régulièrement évacuées et, par manque de place sur la petite île qui abritait la ville, rituellement dispersées –comme pour une tombe de marin– en les chargeant dans de vieux navires qui étaient alors coulés en pleine mer. Vu les quantités, la théorie d’une telle favissa maritime semble plus plausible que celle d’un bateau chargés d’objets religieux ayant fait naufrage, par exemple en cinglant vers Carthage. Des statuettes de ce type sont toujours inconnues dans le monde punique ou même dans l’île de Chypre tout proche. Bien que la plupart d’entre elles remontent à la période perse, quelques-unes sont archaïques. C’est le cas de la représentation d’une musicienne voilée jouant de la lyre et datée du 8e siècle, un type par ailleurs attesté par une statuette en bronze provenant de Tyr et actuellement conservée à Copenhague. E.G.

↑ , Statuette votive d'orant:
Statuette votive d'orant :
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.04598
objectName :
objectTitle : Statuette votive d'orant
objectCulture : Phénicienne
geography :
dating : 400 BC - 301 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 17,5 cm, Largeur: 5,1 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Après une tempête en mer qui eut lieu dans les années soixante, plusieurs statuettes en terre cuite échouèrent sur la plage aux environs de la ville de Tyr et mirent des plongeurs amateurs sur la piste de la cargaison d’une ou de plusieurs épaves de bateaux chargés de statuettes votives. Le nombre de ces statuettes, qui envahirent ensuite le marché de l’art, est de l’ordre du millier d’exemplaires. Elles représentent des orants et des orantes posés sur des socles parfois décorés de coupes d’offrandes et/ou de symboles tels que des dauphins, des ancres ou le signe dit de Tanit. Il est possible que les offrandes des sanctuaires très fréquentés de Tyr étaient régulièrement évacuées et, par manque de place sur la petite île qui abritait la ville, rituellement dispersées –comme pour une tombe de marin– en les chargeant dans de vieux navires qui étaient alors coulés en pleine mer. Vu les quantités, la théorie d’une telle favissa maritime semble plus plausible que celle d’un bateau chargés d’objets religieux ayant fait naufrage, par exemple en cinglant vers Carthage. Des statuettes de ce type sont toujours inconnues dans le monde punique ou même dans l’île de Chypre tout proche. Bien que la plupart d’entre elles remontent à la période perse, quelques-unes sont archaïques. C’est le cas de la représentation d’une musicienne voilée jouant de la lyre et datée du 8e siècle, un type par ailleurs attesté par une statuette en bronze provenant de Tyr et actuellement conservée à Copenhague. E.G.

↑ , Statuette votive d'orant:
Statuette votive d'orant :
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.04599
objectName :
objectTitle : Statuette votive d'orant
objectCulture : Phénicienne
geography :
dating : 800 BC - 301 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 17,9 cm, Largeur: 5,9 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Après une tempête en mer qui eut lieu dans les années soixante, plusieurs statuettes en terre cuite échouèrent sur la plage aux environs de la ville de Tyr et mirent des plongeurs amateurs sur la piste de la cargaison d’une ou de plusieurs épaves de bateaux chargés de statuettes votives. Le nombre de ces statuettes, qui envahirent ensuite le marché de l’art, est de l’ordre du millier d’exemplaires. Elles représentent des orants et des orantes posés sur des socles parfois décorés de coupes d’offrandes et/ou de symboles tels que des dauphins, des ancres ou le signe dit de Tanit. Il est possible que les offrandes des sanctuaires très fréquentés de Tyr étaient régulièrement évacuées et, par manque de place sur la petite île qui abritait la ville, rituellement dispersées –comme pour une tombe de marin– en les chargeant dans de vieux navires qui étaient alors coulés en pleine mer. Vu les quantités, la théorie d’une telle favissa maritime semble plus plausible que celle d’un bateau chargés d’objets religieux ayant fait naufrage, par exemple en cinglant vers Carthage. Des statuettes de ce type sont toujours inconnues dans le monde punique ou même dans l’île de Chypre tout proche. Bien que la plupart d’entre elles remontent à la période perse, quelques-unes sont archaïques. C’est le cas de la représentation d’une musicienne voilée jouant de la lyre et datée du 8e siècle, un type par ailleurs attesté par une statuette en bronze provenant de Tyr et actuellement conservée à Copenhague. E.G.

↑ , Statuette votive d'orant:
Statuette votive d'orant :
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.04600
objectName :
objectTitle : Statuette votive d'orant
objectCulture : Phénicienne
geography :
dating : 800 BC - 301 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 18,2 cm, Largeur: 5,9 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Après une tempête en mer qui eut lieu dans les années soixante, plusieurs statuettes en terre cuite échouèrent sur la plage aux environs de la ville de Tyr et mirent des plongeurs amateurs sur la piste de la cargaison d’une ou de plusieurs épaves de bateaux chargés de statuettes votives. Le nombre de ces statuettes, qui envahirent ensuite le marché de l’art, est de l’ordre du millier d’exemplaires. Elles représentent des orants et des orantes posés sur des socles parfois décorés de coupes d’offrandes et/ou de symboles tels que des dauphins, des ancres ou le signe dit de Tanit. Il est possible que les offrandes des sanctuaires très fréquentés de Tyr étaient régulièrement évacuées et, par manque de place sur la petite île qui abritait la ville, rituellement dispersées –comme pour une tombe de marin– en les chargeant dans de vieux navires qui étaient alors coulés en pleine mer. Vu les quantités, la théorie d’une telle favissa maritime semble plus plausible que celle d’un bateau chargés d’objets religieux ayant fait naufrage, par exemple en cinglant vers Carthage. Des statuettes de ce type sont toujours inconnues dans le monde punique ou même dans l’île de Chypre tout proche. Bien que la plupart d’entre elles remontent à la période perse, quelques-unes sont archaïques. C’est le cas de la représentation d’une musicienne voilée jouant de la lyre et datée du 8e siècle, un type par ailleurs attesté par une statuette en bronze provenant de Tyr et actuellement conservée à Copenhague. E.G.

↑ , Statuette votive d'orant:
Statuette votive d'orant :
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.04696
objectName :
objectTitle : Statuette votive d'orant
objectCulture : Phénicienne
geography :
dating : 800 BC - 301 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 35 cm, Largeur: 8,7 cm, Profondeur: 6,4 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Orante voilée sur socle en forme de pylône. Après une tempête en mer qui eut lieu dans les années soixante, plusieurs statuettes en terre cuite échouèrent sur la plage aux environs de la ville de Tyr et mirent des plongeurs amateurs sur la piste de la cargaison d’une ou de plusieurs épaves de bateaux chargés de statuettes votives. Le nombre de ces statuettes, qui envahirent ensuite le marché de l’art, est de l’ordre du millier d’exemplaires. Elles représentent des orants et des orantes posés sur des socles parfois décorés de coupes d’offrandes et/ou de symboles tels que des dauphins, des ancres ou le signe dit de Tanit. Il est possible que les offrandes des sanctuaires très fréquentés de Tyr étaient régulièrement évacuées et, par manque de place sur la petite île qui abritait la ville, rituellement dispersées –comme pour une tombe de marin– en les chargeant dans de vieux navires qui étaient alors coulés en pleine mer. Vu les quantités, la théorie d’une telle favissa maritime semble plus plausible que celle d’un bateau chargés d’objets religieux ayant fait naufrage, par exemple en cinglant vers Carthage. Des statuettes de ce type sont toujours inconnues dans le monde punique ou même dans l’île de Chypre tout proche. Bien que la plupart d’entre elles remontent à la période perse, quelques-unes sont archaïques. C’est le cas de la représentation d’une musicienne voilée jouant de la lyre et datée du 8e siècle, un type par ailleurs attesté par une statuette en bronze provenant de Tyr et actuellement conservée à Copenhague. E.G.

↑ , Statuette votive d'orant:
Statuette votive d'orant :
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.04697
objectName :
objectTitle : Statuette votive d'orant
objectCulture : Phénicienne
geography :
dating : 800 BC - 301 BC
material :
technique :
dimensions :
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Après une tempête en mer qui eut lieu dans les années soixante, plusieurs statuettes en terre cuite échouèrent sur la plage aux environs de la ville de Tyr et mirent des plongeurs amateurs sur la piste de la cargaison d’une ou de plusieurs épaves de bateaux chargés de statuettes votives. Le nombre de ces statuettes, qui envahirent ensuite le marché de l’art, est de l’ordre du millier d’exemplaires. Elles représentent des orants et des orantes posés sur des socles parfois décorés de coupes d’offrandes et/ou de symboles tels que des dauphins, des ancres ou le signe dit de Tanit. Il est possible que les offrandes des sanctuaires très fréquentés de Tyr étaient régulièrement évacuées et, par manque de place sur la petite île qui abritait la ville, rituellement dispersées –comme pour une tombe de marin– en les chargeant dans de vieux navires qui étaient alors coulés en pleine mer. Vu les quantités, la théorie d’une telle favissa maritime semble plus plausible que celle d’un bateau chargés d’objets religieux ayant fait naufrage, par exemple en cinglant vers Carthage. Des statuettes de ce type sont toujours inconnues dans le monde punique ou même dans l’île de Chypre tout proche. Bien que la plupart d’entre elles remontent à la période perse, quelques-unes sont archaïques. C’est le cas de la représentation d’une musicienne voilée jouant de la lyre et datée du 8e siècle, un type par ailleurs attesté par une statuette en bronze provenant de Tyr et actuellement conservée à Copenhague. E.G.

↑ , Statuette votive d'orant:
Statuette votive d'orant :
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.04698
objectName :
objectTitle : Statuette votive d'orant
objectCulture : Phénicienne
geography :
dating : 800 BC - 301 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 18,5 cm, Largeur: 3,8 cm, Profondeur: 3,1 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Déesse-mère sur socle en forme de pylône (Cf. O.4696) Après une tempête en mer qui eut lieu dans les années soixante, plusieurs statuettes en terre cuite échouèrent sur la plage aux environs de la ville de Tyr et mirent des plongeurs amateurs sur la piste de la cargaison d’une ou de plusieurs épaves de bateaux chargés de statuettes votives. Le nombre de ces statuettes, qui envahirent ensuite le marché de l’art, est de l’ordre du millier d’exemplaires. Elles représentent des orants et des orantes posés sur des socles parfois décorés de coupes d’offrandes et/ou de symboles tels que des dauphins, des ancres ou le signe dit de Tanit. Il est possible que les offrandes des sanctuaires très fréquentés de Tyr étaient régulièrement évacuées et, par manque de place sur la petite île qui abritait la ville, rituellement dispersées –comme pour une tombe de marin– en les chargeant dans de vieux navires qui étaient alors coulés en pleine mer. Vu les quantités, la théorie d’une telle favissa maritime semble plus plausible que celle d’un bateau chargés d’objets religieux ayant fait naufrage, par exemple en cinglant vers Carthage. Des statuettes de ce type sont toujours inconnues dans le monde punique ou même dans l’île de Chypre tout proche. Bien que la plupart d’entre elles remontent à la période perse, quelques-unes sont archaïques. C’est le cas de la représentation d’une musicienne voilée jouant de la lyre et datée du 8e siècle, un type par ailleurs attesté par une statuette en bronze provenant de Tyr et actuellement conservée à Copenhague. E.G.

↑ , Statuette votive d'orant:
Statuette votive d'orant :
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.04699
objectName :
objectTitle : Statuette votive d'orant
objectCulture : Phénicienne
geography :
dating : 800 BC - 301 BC
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 17,5 cm, Largeur: 4 cm, Profondeur: 3,6 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Après une tempête en mer qui eut lieu dans les années soixante, plusieurs statuettes en terre cuite échouèrent sur la plage aux environs de la ville de Tyr et mirent des plongeurs amateurs sur la piste de la cargaison d’une ou de plusieurs épaves de bateaux chargés de statuettes votives. Le nombre de ces statuettes, qui envahirent ensuite le marché de l’art, est de l’ordre du millier d’exemplaires. Elles représentent des orants et des orantes posés sur des socles parfois décorés de coupes d’offrandes et/ou de symboles tels que des dauphins, des ancres ou le signe dit de Tanit. Il est possible que les offrandes des sanctuaires très fréquentés de Tyr étaient régulièrement évacuées et, par manque de place sur la petite île qui abritait la ville, rituellement dispersées –comme pour une tombe de marin– en les chargeant dans de vieux navires qui étaient alors coulés en pleine mer. Vu les quantités, la théorie d’une telle favissa maritime semble plus plausible que celle d’un bateau chargés d’objets religieux ayant fait naufrage, par exemple en cinglant vers Carthage. Des statuettes de ce type sont toujours inconnues dans le monde punique ou même dans l’île de Chypre tout proche. Bien que la plupart d’entre elles remontent à la période perse, quelques-unes sont archaïques. C’est le cas de la représentation d’une musicienne voilée jouant de la lyre et datée du 8e siècle, un type par ailleurs attesté par une statuette en bronze provenant de Tyr et actuellement conservée à Copenhague. E.G.

↑ , Statuette votive d'orant:
Statuette votive d'orant :
collectionName : Proche-OrientinventoryNb : O.04700
objectName :
objectTitle : Statuette votive d'orant
objectCulture : Phénicienne
geography :
dating : 800 BC - 701 BC Inconnue
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 20,5 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Déesse voilée jouant de la lyre. Après une tempête en mer qui eut lieu dans les années soixante, plusieurs statuettes en terre cuite échouèrent sur la plage aux environs de la ville de Tyr et mirent des plongeurs amateurs sur la piste de la cargaison d’une ou de plusieurs épaves de bateaux chargés de statuettes votives. Le nombre de ces statuettes, qui envahirent ensuite le marché de l’art, est de l’ordre du millier d’exemplaires. Elles représentent des orants et des orantes posés sur des socles parfois décorés de coupes d’offrandes et/ou de symboles tels que des dauphins, des ancres ou le signe dit de Tanit. Il est possible que les offrandes des sanctuaires très fréquentés de Tyr étaient régulièrement évacuées et, par manque de place sur la petite île qui abritait la ville, rituellement dispersées –comme pour une tombe de marin– en les chargeant dans de vieux navires qui étaient alors coulés en pleine mer. Vu les quantités, la théorie d’une telle favissa maritime semble plus plausible que celle d’un bateau chargés d’objets religieux ayant fait naufrage, par exemple en cinglant vers Carthage. Des statuettes de ce type sont toujours inconnues dans le monde punique ou même dans l’île de Chypre tout proche. Bien que la plupart d’entre elles remontent à la période perse, quelques-unes sont archaïques. C’est le cas de la représentation d’une musicienne voilée jouant de la lyre et datée du 8e siècle, un type par ailleurs attesté par une statuette en bronze provenant de Tyr et actuellement conservée à Copenhague. E.G.

↑ , Coupé:
Coupé :
collectionName : Voitures hippomobilesinventoryNb : TR.830
objectName :
objectTitle : Coupé
objectCulture :
geography :
dating :
material :
technique :
dimensions : Hauteur: 23,5 cm, Largeur: 31 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Petit coupé de ville noir avec lanternes et marchepied, freins à volant, bandage caoutchouté possible.

↑ , Landaulet:
Landaulet :
collectionName : Voitures hippomobilesinventoryNb : TR.831
objectName :
objectTitle : Landaulet
objectCulture :
geography :
dating :
material :
technique :
dimensions : Largeur: 31 cm
legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
objectDescription : Petit landaulet noir avec lanternes et marchepied, freins à volant, bandage caoutchouté possible, les panneaux de custode arrière sont remplacés par une capote tendue sur compas.

